Qu’est-ce que l’écologie urbaine ?
Nous publions un entretien critique à propos d’un Manuel d’écologie urbaine, qui vient de sortir aux Presses du réel. Réponses des auteurs, Audrey Muratet, Myr Muratet et François Chiron1.
Quel a été votre but en écrivant ce livre ? Vous parlez au début d’une « prise de conscience » nécessaire.
Pour beaucoup de citadins, l’écologie signifie recycler ses déchets, réduire sa consommation, utiliser des moyens de transports non polluants, manger bio, etc. La littérature est foisonnante sur ces sujets. Mais l’écologie urbaine est aussi une discipline scientifique. La ville est un écosystème vivant dans lequel des processus écologiques et évolutifs sont à l’œuvre en permanence.
En tant qu’écologues (au sens scientifique et naturaliste du terme), nous souhaitions partager notre émerveillement de la nature en ville, les connaissances que nous avons pu acquérir depuis près de 20 ans mais surtout faire l’état de la recherche en écologie urbaine au niveau mondial, où en est-on, ce qu’il reste à faire, à explorer, à approfondir. Une telle synthèse manquait (en français). Face au verdissement, nous voulions enfin affirmer notre vision de l’écologie urbaine et les orientations urgentes à prendre ou à ne pas prendre.
Nous voulions sortir du cadre académique pour que ce partage de connaissance dépasse la seule assemblée scientifique et soit disponible pour tous les habitants des villes. Nous souhaitions également apporter une dimension sensible de la ville et de ses habitants, c’est pourquoi nous avons travaillé avec un photographe et un poète.

En général quand on pense à l’écologie, on s’imagine de la nature sauvage, des forêts, des montagnes, et des milieux dévastés par les activités économiques. On s’imagine rarement ce que pourrait être l’écologie en ville. Qu’est-ce que l’écologie urbaine ?
Une écologie qui s’intéresse au milieu urbain, aux individus, aux espèces et aux communautés qui s’y développent, y évoluent, interagissent entre elles et avec leur environnement. Toutes les théories, tous les concepts utilisés par l’écologie dans des milieux dits « naturels » sont transposables au milieu urbain, seul le contexte d’étude change. L’écologie urbaine est aussi l’écologie des villes dans leur globalité, la reconnaissance et l’étude des interactions entre sociétés humaines et non humaines.
Comme vous le faites remarquer, les villes sont au cœur du problème écologique. Faut-il penser que les villes sont condamnées écologiquement, qu’on ne pourra pas y habiter si l’on veut arriver à une société plus juste, à une agriculture et une petite industrie locales ? Faut-il un « exode urbain » ?
Nous ne pensons pas que les villes sont condamnées écologiquement. Plus on les étudie plus on se rend compte qu’elles abritent une biodiversité dont le nombre d’espèces est comparable aux milieux ruraux mais aussi plus fragile (effectifs plus réduits, moins de biomasse, des sols imperméabilisées, etc.). De plus, il existe de grandes disparités entre villes. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de proposer des études en écologie qui sortent de la ville pour étudier les villes, les différentes conceptions, histoires, cultures, les liens avec les espaces anthropisés ou plus naturels voisins à la ville, afin de comprendre les mécanismes menant à des fonctionnements écologiques viables pour tous.
Face à une augmentation de la population urbaine, il nous semble important de réfléchir à une conception de villes viables mais l’exode urbain prôné par Pierre-Henri Gouyon dans notre postface est aussi une option à développer. Une agriculture sans pesticides et basé sur un modèle « paysan » requiert plus d’humains dans les champs. Il faudrait donc réfléchir aussi à l’accompagnement de ces différents choix.

Vous opposez une approche « sensible » de la nature à une approche « scientifique » trop froide, trop distante. Qu’est-ce qu’une écologie sensible ? Quels sont les défauts de la science ?
Nous ne cherchons pas à opposer mais au contraire mêler ces approches sensibles et scientifiques qui s’enrichissent mutuellement. Le discours scientifique est le plus possible dénué de perception individuelle pour limiter les influences, les biais de toute nature dans la description et la compréhension de notre environnement, tant dans sa composition que dans les processus qui l’animent. Alors que le travail de l’artiste est la perception d’une personne de son environnement avec ses sens, ses émotions et qui est retranscrit dans ses œuvres. Les deux sont essentiels pour rendre sensible le discours scientifique.
Le concept de « biodiversité » est au coeur de vos analyses : l’objet de votre ouvrage est de montrer qu’il y a une biodiversité urbaine très « riche ». Le concept de biodiversité a fait l’objet d’une critique trop peu connue2 : il serait l’héritage d’une vision économiste de la nature, qui souhaite chiffrer la « richesse » d’un stock naturel par le nombre et la diversité des espèces qui y coexistent. Le concept de biodiversité reposerait sur l’idée, désormais contredite, que plus un milieu est riche en biodiversité, plus il est stable, et plus il nous fournit de « ressources ». Plus un milieu est « riche », plus on pensait qu’il rendait « riches » ceux qui l’exploitent et le préservent.
Cette idée est d’ailleurs en partie abandonnée par la science écologique contemporaine, qui commence à dire qu’on peut très bien sacrifier des espèces sans mettre en péril l’équilibre d’un milieu (avec la métaphore de l’avion qui perd un boulon mais qui continue de fonctionner). Puisque le concept de biodiversité est devenu trop contraignant pour les gestionnaires, les économistes sont en train de lui substituer le concept de « service écosystémique » : l’idée est qu’en fait on s’en fiche de la « biodiversité », et que ce qui compte, c’est de préserver uniquement la nature « utile », celle qui nous fournit des « services ».
Voici notre question : si l’on souhaite vraiment défendre les milieux vivants, ne faudrait-il pas abandonner le concept de biodiversité (et celui de « services écosystémiques », cela va sans dire) ? Ne faudrait-il pas sortir de ces histoires de quantité, pour retrouver une approche qualitative de la nature ? Ne faudrait-il pas souligner que ce qui rend un milieu habitable, vivant, attachant, ce n’est pas sa « richesse » en biodiversité, ni les « services » qu’il rend, mais d’abord les liens sensibles qui s’effectuent entre les êtres qui l’habitent ?
On ne réduit pas du tout le concept de biodiversité à un nombre d’espèces, on ne chiffre pas, on décrit. La biodiversité des villes, oui, est au cœur de notre manuel en tant que diversité d’individus, d’espèces, de traits écologiques et fonctionnels, d’histoires évolutives, d’interactions complexes, etc. Cette description à la fois quantitative et qualitative est essentielle pour aller plus loin dans la compréhension des dynamiques et du fonctionnement écologique. On ne se fiche pas de la biodiversité, on la considère dans son intégrité, dans ses interactions, ses fonctions, son évolution. Nous avons, par contre décidé de ne pas employer la notion de « service écosystémique » dans notre description de la biodiversité urbaine. Ce terme place l’être humain au-dessus du reste du vivant qui est jugé alors comme à son service.
Les études explorant les relations entre diversité spécifique, fonctions écologiques, stabilité écologique, résilience des écosystèmes ont fait l’objet de critiques, en effet. Celles-ci portent surtout sur les méthodes d’expérimentation employées pour mettre en évidence ces relations. Une méta-analyse récente (https://www.nature.com/articles/nature23886) confirme néanmoins les tendances connues. Il n’est pas possible d’affirmer que l’écologie contemporaine réfute l’idée d’une relation entre biodiversité, stabilité, et ressources, mais bien l’inverse
D’autre part, le concept de redondance écologique auquel vous faites référence (vous dites « sacrifier sans mettre en péril ») est un concept qui ne justifie pas la destruction des espèces mais qui alerte au contraire sur les seuils de biodiversité en deçà desquels la trajectoire des systèmes écologiques change (on perd la résilience écologique). La redondance écologique permet de faire face aux changements globaux. Enfin, restons modeste car on ignore encore beaucoup des conséquences de la perte d’espèces sur les réseaux écologiques et le fonctionnement des écosystèmes (voir théorie des systèmes).
Nous critiquons l’argument de non utilité du vivant dans notre livre qui n’est pas éthiquement recevable pour détruire une espèce.
Nous ne comprenons pas l’idée d’associer richesse en espèces d’un milieu et richesse des personnes qui l’exploitent. Attention à de tels raccourcis, les plus riches exploitations de ressources naturelles (agricoles, sylvicoles, piscicoles, etc.) que nous connaissons sont aussi celles qui sont le plus pauvres en biodiversité (cf. les plaines céréalières intensives de France).

Quelle place y a-t-il pour les humains dans l’écologie urbaine ? Finalement, si votre travail est accompagné de très belles photos montrant des « écosystèmes urbains » avec des humains, votre texte reste très axé sur la place des végétaux et des animaux dans la ville. N’est-ce pas justement parce que vous donnez la primauté au concept de « biodiversité » (quantité d’un stock de ressources naturelles) sur celui de « milieu vivant » (qualité d’un ensemble d’attachements entre humains, végétaux, animaux, minéraux, etc.) ?
Dans notre livre, la biodiversité n’est pas abordée sous la forme d’un stock de ressources naturelles mais sous toutes ses formes, et nous insistons sur l’importance de ce « tissu vivant » cher à Robert Barbault.
L’analyse des sociétés humaines qui peuplent ces villes, leurs interactions avec le reste de la biodiversité ne sont que survolées dans le texte car nos compétences dans ce domaine sont limitées. Mais comme vous le soulignez, le travail photographique présenté apporte une vision des communautés humaines des villes qui nous semble justement compléter l’approche écologique. Les photographies de ce manuel ne sont pas des illustrations du texte des écologues mais un travail mené indépendamment. Nous apportons ici nos regards d’écologues, de photographe et nous espérons pouvoir y associer une vision anthropologique dans l’avenir.
Vous saluez les grèves des jeunes pour le climat par une belle photo. Qu’avez-vous pensé de ces grèves et des ces marches ? Vous semble-t-il qu’elles pourraient amener à des changements conséquents ? Quels conseils donneriez-vous aux jeunes ?
Nous saluons toutes les actions menées pour révéler l’urgence climatique et écologique. Ces grèves sont nécessaires pour propager cette prise de conscience et mobiliser encore plus de monde. Elles sont aussi l’expression d’un changement dans les actions. Face à l’ampleur de la crise, on peut se sentir démunis mais ce sont bien des actions (voire des non actions) locales qui ont mené à des changements conséquents.
A la fin du livre, vous proposez un panel de solutions pour défendre l’écologie urbaine. Vous mentionnez notamment la « surconsommation ». Les consommateurs n’existent que depuis le capitalisme fordiste, qui les a inventés et produits activement, et vous soulignez vous-mêmes que ceux qui « consomment » le plus, ce sont les grands producteurs, les multinationales, etc. La destruction des milieux vivants n’est-elle pas le fait d’un mode de production (et de surproduction), bien plus que de la « surconsommation » (un concept qui vise un peu trop les « petites gens » pour être honnête) ?
Oui il s’agit bien des modes de production et de consommation qui sont discutés dans notre ouvrage par le constat de leurs effets sur la biodiversité. Ce constat n’est pas idéologique, il se base sur les faits. Il a nécessairement des implications politiques si notre société souhaite s’engager dans la protection de notre planète. Notre rôle est d’apporter les éléments pour nourrir ce débat.
Vos propositions semblent adressées aux « élus, gestionnaires, écologues, aménageurs ». Mais est-ce que ce ne sont pas ces crapules, précisément, qui ont ravagé la nature ? Est-il bien sage de remettre dans les mains des « décideurs » et de leurs experts le sort de milieux qu’ils ont contribués à détruire ? Lorsque vous parlez d’écologie « sensible », on s’imagine plutôt que ce sont d’abord ceux qui ont un rapport sensible aux milieux qui doivent décider. C’est-à-dire les gens qui les habitent, et pas les « gestionnaires ».
Ce jugement porté à l’égard des « élus, gestionnaires, écologues, aménageurs » est hâtif et facile. Nous côtoyons régulièrement des gestionnaires et des décideurs sensibles et engagés dans la protection de la nature. En tant qu’écologues nous réalisons des expertises qui visent à accompagner au mieux cette gestion et les choix d’aménagements. Mais il est vrai que les enjeux écologiques se retrouvent toujours très loin dans les priorités d’une collectivité. Oui, notre manuel s’adresse aux habitants, aux élus, gestionnaires, écologues et aménageurs qui souhaitent comprendre et agir en faveur de la biodiversité qu’ils côtoient et gèrent
De plus, la sensibilité à la nature n’est pas exclusive à un groupe de personnes. Elle n’est pas innée, elle doit se transmettre, s’apprendre, évoluer, elle est contextuelle, personnelle, etc. Qui pourrait prétendre être plus sensible qu’un autre à la nature et décider pour les autres ?

Que pensez-vous de la ZAD ? Entre urbain et rural, pourrait-elle être un modèle pour l’écologie à venir ?
La ZAD est une forme d’organisation collective afin de défendre un lieu, des enjeux, des valeurs, des gens, etc. Ce sont des expériences intéressantes pour tester la mise en pratique des principes écologiques que nous proposons mais aussi pour en inventer d’autres, qui pourraient être eux aussi soumis au regard des scientifiques. Les ZAD sont des actions qui doivent être menées pour remettre l’écologie au devant des priorités plus commerciales et économiques. La finalité de notre livre est la même, même si notre livre n’est pas un livre d’écologie politique au sens premier.
Au début du livre, vous mentionnez la nécessité urgente d’ « arrêter de détruire » les milieux vivants. Il est dommage que cette idée disparaisse à la fin du livre, lorsque vous faites vos propositions d’action. Quelles sont ces forces qui détruisent les milieux vivants ? Comment pourrait-on arrêter la destruction ? De plus en plus, certains écologistes, notamment les jeunes, songent à mettre un coup d’arrêt à la machine économique.
Cette nécessité d’arrêter de détruire se maintient dans nos propositions, le paragraphe « préserver le passé » lui est dédié. Nos propositions ne peuvent être que larges car les solutions à mettre en place sur le terrain doivent être contextualisées. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans nos recommandations sans prendre le risque de proposer des choses qui souffriraient d’une forte répétition.
Les forces à l’origine de la destruction des milieux vivants sont multiples et sont liées à notre mode d’exploitation de notre environnement. Les leviers encourageant cette exploitation au delà de nos besoins sont nombreux. Le levier économique en est un important.
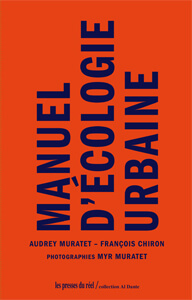
Notes
| 1. | ↑ | Audrey Muratet explore et étudie la composition et la dynamique de la biodiversité des villes. Elle étend ses travaux d’écologue et de botaniste en associant à sa recherche l’approche de géographes, de sociologues, d’anthropologues, de gestionnaires et la pratique d’artistes. Docteure en écologie de l’université Pierre et Marie Curie et botaniste formée au Conservatoire botanique du Bassin parisien, elle a mené ses premiers travaux en écologie urbaine au Muséum national d’histoire naturelle. Depuis 2015, elle travaille à l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France au sein de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France. Hors ses publications scientifiques, elle a publié de nombreux guides naturalistes dont la Flore des friches urbaines, avec Myr Muratet et Marie Pellaton, éd. Xavier Barral, 2017. Écologue, spécialiste des oiseaux et des mammifères, François Chiron parcourt et étudie les paysages les plus transformés par l’Homme : urbains et agricoles. Il se passionne pour les capacités de la nature à s’adapter et à évoluer dans ces environnements bouleversés et mouvants. Ses travaux permettent de repenser la place d’espèces jugées indésirables (nuisibles, invasives) et d’imaginer des solutions pour une meilleure conciliation entre activités humaines et conservation de la nature. Après plusieurs expériences dans des laboratoires français et étrangers, il est depuis 2013, Maître de conférences. Il enseigne à AgroParisTech et mène ses recherches à l’Université Paris-Saclay. Le travail photographique de Myr Muratet implique la ville – celle où il vit –, mené depuis ses crans, multipliant les allers et retours dans des lieux occupés et au gré des rencontres avec les personnes photographiées, des années durant. Ainsi réalise-t-il Paris-Nord, une série de photographies sur un groupe polyconsomateurs et occupants de la gare du Nord, ses alentours et les dispositifs mis en place pour les contraindre ; Wasteland, une recherche autour des notions d’occupation, d’invasion, d’enclosure menée dans les friches urbaines de Seine-Saint- Denis ; ou CityWalk, sur quelques conséquences de l’avancée du Grand-Paris. Déjà paru : Flore des friches urbaines, op. cit., éd. Xavier Barral, 2017 ; La Sécurité des personnes et des biens, avec le poète Manuel Joseph, éd. P.O.L, 2010. |
| 2. | ↑ | Voir l’article « Une nature liquide » de Christophe Bonneuil, https://books.openedition.org/irdeditions/21885?lang=fr |




