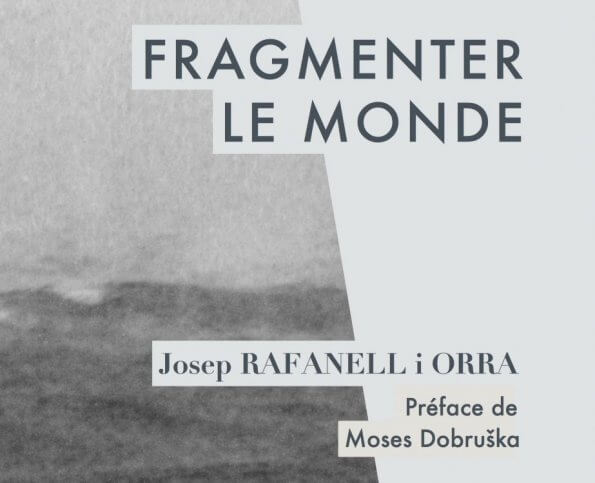N’apprenons pas à vivre dans les ruines
En lisant Fragmenter le monde de Josep Rafanell i Orra
« Et toi, c’est quoi tes qualités et tes défauts ? », sacrée question, moquons-nous en mais sans doute cette rengaine dit-elle beaucoup de nos sociétés. La méthode a beau varier, personne n’échappe au contrôle d’identité. C’est que notre monde aime ce qui est bien identifié et compartimenté, lui-même se dépeint ainsi : unitaire, discernable, tout rond. Mais une plus fine perception nous apprend que son architecture n’arrête pas de s’effondrer, comme un château en ruine dont on essayerait tant bien que mal de coller les morceaux à la glu : les gardiens veillent à ce que personne ne puisse voir les fissures.
Au risque de reconduire une métaphore éculée, disons que Josep Rafanell i Orra tente de nous ouvrir les yeux. Le monde ne se tient qu’en tant qu’il se désagrège. Plus qu’un constat, cette ouverture du regard ouvre des possibilités stratégiques inédites. La lecture de Fragmenter le monde (éd. Divergences) est vertigineuse tant le livre est dense, plutôt court (100p) et direct. Matrice peu connue de bien des réflexions qui parcourent Maintenant du Comité invisible, il s’en écarte en insistant avant tout sur la valeur positive des fragments et l’importance de l’enquête. Comme d’habitude, il est écrit dans le savoureux dialecte rafanellien. Nous vous en livrons une introduction.
Le monde se fragmente : c’est moins une affaire de description objective, complète et minutieuse que de sentiment, de perception, de positionnement. Sous des dehors mono-explicatifs et définitifs, la « fragmentation du monde » est un modèle d’interprétation qui se tient, parce qu’il est à tiroirs : on peut lui faire dire bien des choses, et des choses très justes, aussi bien du point de vue de ce que l’on subit (on se fragmente, notre monde se fragmente), que du point de ce qu’il y a à faire : s’approprier cette fragmentation. Le plus sûr signe de la pertinence de ce thème, c’est qu’il plaît à l’époque et lui colle à la peau : un article intitulé « Jeunes et déjà sans avenir » conclut par exemple : « Si l’avenir peut paraître bouché pour les enfants de la désindustrialisation, leur horizon social est de plus en plus fragmenté« .
Il n’y a rien de mystérieux dans la fragmentation : nous avons trop longtemps vécu dans un monde qui cherche à tout unifier en lui. Ces vecteurs d’unification se nomment Etat, colonisation, individu, société, personne, culture, ville, nation, auteur, République, genre, race… Autant de cadres trop étroits, de catégories déposées sur la réalité qui nous en imposent une lecture singulière. La République c’est ceci ; l’Etat fait cela ; je suis comme ci ou comme ça. L’ennui, c’est que le réel (la République, l’Etat, le moi) est pluriel, changeant, multiple, traversé par des forces contradictoires.
Toujours, il y a eu des résistances, des déviances, des hostilités plus ou moins déclarées aux forces d’unification. Aujourd’hui, alors que le processus d’unification atteint son apogée (mondialisation), l’étouffement devient insupportable, et sous la pression, ce monde un se désagrège. Partout, des lignes de fuite s’amorcent, et à diverses échelles, à divers niveaux de conscience, la foi dans les institutions de ce monde s’effondre : abstention, sécession, « repli sur soi », dépression, transgressions, troubles de l’identité, burn-out, schizophrénies, volontés d’autonomie, « communautarisme », dégradations urbaines, actes étranges, refus du travail, mauvais esprit, cynisme, besoin de commun, de contact, d’intimité, de « déconnexion », etc.
La liste infinie des phénomènes de fragmentation est en ce sens moins un inventaire des pathologies de notre temps, que les symptômes d’une lutte générale contre ce monde malade son homogénéité froide et étrangère. Cet opuscule de Josep Rafanell, Fragmenter le monde, est un geste stratégique qui prend acte du caractère positif de cette situation : il nous appartient de nous approprier et de composer ces pas de côté qui se dessinent partout, ces personnes, ces actes, ces lieux qui se détachent fragment par fragment du monde de l’économie ; l’enjeu étant bien sûr de maintenir leur état fragmentaire, leur multiplicité, qui est aussi leur force, la condition de leur vitalité. Il y a là une chance historique, mais aussi un travail d’une immensité accablante.
La « fragmentation du monde » de l’économie
D’où part Josep Rafanell ? De ce que la nature décelable de notre monde est une mécanique de l’assimilation de tout ce qui existe au Tout de l’économie. L’économie est la main invisible qui découpe dans le réel les identités et les différences dont elle a besoin pour prospérer ; autant de carcans étroits pour nos vies qui ne demandent qu’à déborder.
L’économie capitaliste a toujours progressé par contamination et infiltration du tissu des rapports humains1, en remplaçant les liens communautaires par des liens économiques : extension des échanges depuis l’Angleterre à la surface entière du globe, quadrillage du temps entre travail et loisirs, aménagement des territoires, marchandisation des « secteurs » de la vie humaine (culture, information, politique, arts), insinuation jusqu’aux tréfonds du « moi » des sujets contemporains, avec cet appel constant à se valoriser, à se gérer et gérer sa vie comme du capital. Il y a un « Tout » de l’économie (en construction permanente), car il y a cette logique d’homogénéisation, d’unification, d’intégration de tout aux flux et aux marchés de l’économie. La mondialisation est la phase terminale de ce processus.
Dans ce milieu où nous baignons, nous avons tendance à penser et à vivre nos vies selon les représentations prêtes-à-porter qu’on nous fournit. Une amie potentielle ne sera que la caissière des courses du samedi, l’enfant avec qui je faisais de la pâte à modeler devient un collègue de bureau, la chambre d’ami devient une location Airbnb, la balade revigorante devient un trajet Google Maps ou une flânerie commerciale, la flemme ou la contemplation deviennent une perte de temps, ma dépendance à une drogue devient une addiction handicapante, la dépression devient une maladie individuelle qui doit être traitée médicalement… Tout doit être calculable, prévisible, rentable.
A ce moment-là où tout ne doit plus se dire et se vivre que dans le langage morne de l’économie, nous sommes devenus les plus indifférents les uns aux autres. Nous sommes en passe de devenir des étrangers, séparés artificiellement par les multiples cloisons, vitrines et écrans du monde-marchandise. Nous sommes sommés de mouler notre projet de vie sur les identités et les différences valorisées, ou de rejoindre ceux qui ne sont rien, les marginaux, les surnuméraires, dans les interstices de l’économie. « La vie, définitivement, devient partout, péniblement, un projet. » (p.39)
A la fin, il est naturel d’être lassé de ce manège, où l’on finit par tourner seul en orbite du centre vide du monde. Ce n’est pas tant qu’il y ait un certain découpage du réel qui pose problème, mais plutôt le fait que ce découpage ne puisse suivre que le patron dessiné par les ciseaux de la main invisible. La preuve certaine du caractère étouffant de ce découpage pour toute vie est que d’autres tentatives de fragmentation essaient partout d’affleurer. C’est ce phénomène de fuite, de désertion qui est décrit dans Maintenant du Comité invisible2 comme la « fragmentation du monde ». On sent aujourd’hui que la belle unité du paradis mondialisé craque de toutes parts, au niveau des individus comme au niveau des collectifs. Là où Josep Rafanell n’élabore guère sur la portée théorique de ce phénomène et part plutôt des possibilités qui en naissent, le Comité invisible pousse très loin la spéculation au point d’en faire une clé de lecture historique du « retournement du processus de civilisation » en son contraire :
Quartier suivant quartier, la fragmentation du monde se poursuit, sans ménagement, sans interruption. Et cela n’est pas qu’affaire de géopolitique. C’est en tous domaines que le monde se fragmente, en tous domaines que l’unité est devenue problématique. Il n’y pas plus d’unité dans la « société », de nos jours, que dans la « science ». Le salariat explose en toutes sortes de niches, d’exceptions, de conditions dérogatoires. L’idée de « précariat » occulte opportunément qu’il n’y a tout simplement plus d’expérience commune du travail, même précaire. […] La médecine occidentale en est réduite à bricoler avec des techniques qui font voler en éclats son unité doctrinale, telles que l’acupuncture, l’hypnose ou le magnétisme. Par-delà les usuels tripatouillages parlementaires, il n’y a plus, politiquement, de majorité pour rien. […] Notre Moi lui-même se présente comme un puzzle de plus en plus complexe, de moins moins cohérent — si bien que pour que ça tienne, en plus des séances de psy et des comprimés, il faut maintenant des algorithmes. […] Au regard des puissances transnationales, les Etats ne se maintiennent plus qu’à l’état d’hologrammes. […] Que ce soit sous prétexte de « réforme » ou par accès de « modernisation », les Etats capitalistes contemporains se livrent à un exercice d’auto-démantèlement méthodique. Sans parler des « tentations indépendantistes » qui se multiplient à travers l’Europe. […] Nous sommes les contemporains d’un prodigieux retournement du processus de civilisation en processus de fragmentation3.
Il faut avouer que cette idée de philosophe est plaisante, bien qu’elle fasse peu de cas d’une accréditation historique. Plus qu’un retournement historique réel, elle nomme surtout une chance, une possibilité : celle d’accueillir et d’approprier les processus de fragmentation, alors que la supercherie du « vivre-ensemble » s’éloigne toujours plus à mesure qu’elle s’impose dans le « débat public »4, et devient le plus ridicule symptôme de notre incapacité à associer une valeur positive au fragment. Il n’y a pas à se lamenter de cette fragmentation que l’on voit poindre dans tous les gestes de sécession vis-à-vis de la loi unique du monde de l’économie. Il y a à s’approprier cette logique qui est celle de la vie même, et à prendre soin de cette multiplicité de penchants, d’énergies et de pulsions qui sortent du commun.
Si « le monde » doit être sauvé, ce sera en chacun de ses fragments. La totalité, on ne peut que la gérer.5
Voir les mondes en fragments
Au fond, peu importe que le monde soit réellement en train de vivre un retournement historique de l’unité à la fragmentation. Ce à quoi il faut être sensible, c’est que le monde n’a jamais été autrement qu’en fragments. Le fragmenté n’est pas l’état d’une chose qui était unie et qui a été brisée, c’est si l’on veut l’état premier des choses. Les fragments, bien sûr, sont faits pour s’agencer. Mais certaines unifications contraintes leur font violence. En l’occurrence, le quadrillage du réel défini par le monde de l’économie, qui est devenu dominant dans nos vies, ne fait pas droit à la multiplicité foisonnante de ces vies. Leur multiplicité nous est masquée par les forces qui font de nous des sujets stables, unifiés, réguliers, prévisibles, avec des caractéristiques fixes bien définies.
Il nous faut aiguiser notre oeil pour redécouvrir la multiplicité inhérente aux formes de vie, et parvenir à distinguer la guerre silencieuse qui se trame entre elles. C’est pour cela que l’invisible préfacier de Fragmenter le monde, Moses Dobruška, présente avant tout la fragmentation comme une « machine de perception », une machine à changer le regard (p.18) :
L’idée de fragmentation est une machine de perception. Tout nous incline, en Occident, à voir dans une personne une personne, dans une image une image, dans une ville une ville. C’est une erreur. Une perception fine du réel décèle dans une personne le chaos de forces, le bricolage de pièces en tension, les co-appartenances contradictoires, les fragiles agencements, les flux noués, les démons et les points d’irréductibilité que recouvre opportunément l’apparence extérieure, posée, du sujet6.
Tout être, toute personne est en réalité fragmentaire, composée de penchants différents et d’instincts contradictoires. Les êtres sont fondamentalement multiples, traversés par les autres, habités par leur monde comme ils habitent le monde. Retourner la valeur associée au fragment, c’est se réjouir de cet affront fait par le fragment au monde de l’unification, c’est faire droit à cette multiplicité combinatoire de la vie, dont il s’agit de prendre soin, contre les forces qui cherchent à la mutiler. En réalité, si le monde mondialisé fait entendre des craquements sous l’effet de forces centrifuges, c’est justement parce qu’il n’est qu’un monde parmi d’autres au sein d’une guerre des mondes :
Face à la décomposition du monde commun des ‘super-riches’, plutôt que dans une guerre sociale, nous sommes dans une guerre entre des milieux, ou devant la possibilité ou l’impossibilité de certains mondes à exister. Il y a le milieu global en décomposition, celui du monde total de l’économie dans lequel chacun devrait avoir sa place, entrepreneur dans une start-up ou mendiant dans un bureau d’aide sociale ; ceux qui sont tout et ceux qui n’étant rien sont sommés de devenir quelque chose par la grâce du monde commun de l’économie. Et puis, il y a les milieux singuliers qui s’affirment, fragmentaires, qui bifurquent, récalcitrants, qui interrompent le temps de la gouvernementalité et sa coïncidence avec le temps de l’économie. Ce que nous indique la politique, avant même l’affrontement entre des ‘conceptions’ de la société c’est, d’abord, qu’il y a une incompossibilité entre des mondes. Entre celui d’un avenir probable et ceux, pluriels, des devenirs possibles.7.
Au sein de cette guerre, Josep Rafanell nous invite donc à épouser le parti de la multiplicité, qui n’est pas le pluralisme démocratique. Le pluralisme démocratique est une force totalisante, qui souhaite à tout prix la coexistence pacifique de formes de vie qui n’ont rien de commun. La démocratie ne devient pourtant un besoin que lorsqu’il y a un désaccord, une disharmonie, qui impose un fonctionnement procédurier et dévitalisant. A une échelle nationale, la démocratie a toutes les chances d’être une entourloupe visant à faire passer la juxtaposition de mondes contraires voire hostiles pour une harmonie pacifiée par le suffrage universel (et la police).
Contre un pluralisme factice qui reste totalisant, le parti de la multiplicité nomme d’abord le désir de se défaire des fausses totalités. C’est ce qui occupe Josep Rafanell dans le chapitre 1 de Fragmenter le monde, au sujet notamment de la question écologique. La mise en scène d’une « Nature » (Gaïa, la Planète…) opposée à l’Homme se présente comme la forme la plus récente et la plus évoluée de la vision économique du monde, le dernier chantage à l’unité totale. La dimension monolithique de « la Nature », ravagée globalement par la petite et infâme « nature humaine », suppose une résolution gestionnaire de la crise, par le haut, par le secours d’Etats qui coopèrent sous le contrôle bienveillant des experts. La « Nature », considérée comme notre extérieur radical, devient dans les mains de nos sauveurs une simple ressource, un « environnement », qu’il s’agit non pas d’habiter, mais de gérer, comme on gère un taux de chômage ou un budget.
Fragmenter le monde, l’attitude contraire, revient ici à voir qu’il n’y a pas une Nature, mais des natures particulières (champs, forêts, minerais, mers, etc.) et historiques (une nature n’est pas éternelle, elle change, elle est aménagée) différemment découpées (selon qui découpe), et différemment habitées8. En fait, il y a moins des « natures » que des « mondes », qui désignent certaines configurations d’humain et de non-humain, où nous vivons communément. Un monde peut être un quartier, un « coin de nature », un territoire, un bar PMU, un lieu aimé et chargé de souvenirs, un village, une ancienne voie ferrée, une ZAD, sans parler des mondes fictifs, imaginaires qui peuplent en fait les mondes « réels » et rendent la distinction inutile. Dans un monde, la question la plus fondamentale n’est pas celle de la gestion, mais celle de l’habiter : comment voulons-nous vivre, comment sommes-nous heureux ? Si l’on pose la question de la gestion en premier lieu (comment gérer tel ou tel problème global dans un monde global), on coupe court à l’épanouissement de formes de vie différentes au sein de mondes différents. Ce qu’il faut défendre, ce n’est pas la « Nature », mais des lieux de vie.
Se redonner les moyens d’agir écologiquement c’est donc se situer en dehors des coordonnées habituelles du problème (Homme vs. Nature) qui nous désarment, en reposant la question de l’habiter : « Fragmenter le monde n’est rien d’autre que retrouver des formes de vie par lesquelles être au monde c’est le façonner, faire un monde. Le monde où nous habitons. » (p.37). A l’heure où toute possibilité de configurer le monde nous a été enlevée, il est difficile de voir au-delà de notre impuissance d’agir, qui se résume à l’alternative entre glisser un bulletin dans une urne, ou ajuster nos pratiques de consommation. Pour peu que l’on prenne conscience de ces écueils (le politique ne se joue pas aux élections, les changements de consommation n’ont aucun impact sur les infrastructures de notre monde) et que l’on veuille agir, se pose alors la question du plan.

Fragmentons leur monde, composons les nôtres
Il ne s’agit pas d’apprendre à vivre dans les ruines […] mais de ruiner le projet d’unification du monde.
Au cours d’un entretien très riche, qu’on peut relire pour accompagner Fragmenter le monde, Josep Rafanell nous disait : « Il nous faut un plan ! ». Un plan, ajoutait-il, ce n’est pas un programme, du genre bien ficelé avec des cases à cocher, car le fait de défendre le parti de la multiplicité implique de laisser les mondes émerger librement, hors du carcan des programmes et des projets qui figent les formes d’action collective. On peut dire que ce livre fournit les rudiments de ce plan, ou plutôt ses coordonnées, à partir desquelles se dessinent une option et des actions politiques.
Soit : partons de nos fragments, partons de notre plus grand isolement face au monde unifié de l’économie. Le réquisit minimal d’une telle position est de répondre au problème de la constitution d’une force commune, qui ne reconduise pas à des unités institutionnelles mortifères. Josep Rafanell propose deux idées indissociables : la construction d’ennemis communs, et la composition parallèle des mondes entre eux grâce à des enquêtes, des passages, des traductions.
« La politique suppose, comme toujours, de convoquer un rapport de conflit avec ceux qu’il faut appeler des ennemis » (p.47). L’ennemi commun, pourtant, n’est jamais « donné » d’emblée par des formules aussi générales que vides telles que « les capitalistes », « la police » ou « les patrons ». L’ennemi est à construire (ch.2). « L’ennemi », parce qu’il faut bien admettre que le conflit est irréductible. On ne se mettra jamais d’accord avec le capitalisme mondialisé et ces forces d’unification, d’intégration, de pacification. L’économie n’est pas une personne avec qui on peut parlementer : c’est un ensemble plus ou moins cohérent de mécanismes impersonnels, d’infrastructures immenses, de réseaux, de marchés, de flux, de traités, de centrales, de puits à pétrole, de multinationales, de fonds financiers, etc. Évidemment, ces structures économiques ont leurs acteurs et leurs moyens de défense (« bureaucrates, experts, journalistes, policiers et politiciens… », p.46) qui ne sont pas des ennemis dans l’absolu, mais selon certaines situations. L’ennemi ne peut pas être décrété a priori car il n’a pas le même visage partout.
Quelle forme doit prendre la lutte contre ces ennemis ? La question est délicate, et la réponse est bien sûr tout aussi plurielle et indéterminée. Il faut bien voir que les luttes traditionnelles (grèves, occupations, manifestations, etc.) sont à la fois mobilisatrices mais usées et prises dans les rets du jeu institutionnel. Chez Josep Rafanell, je pense qu’il est moins question de les abandonner que de leur donner une forme destituante. La destitution est en quelque sorte une appropriation consciente du processus de fragmentation : elle ne consiste pas à revendiquer, réclamer, s’indigner, ce qui nous situe d’emblée au sein de la totalité à laquelle il faut échapper, mais à entamer la sécession, et à travailler à l’émergence d’autres puissances, d’autres mondes, d’autres lieux de vie.
La destitution implique de tenir ensemble deux aspects : un travail destructif, pourrait-on dire, qui construit l’ennemi et l’attaque, lui arrache des territoires, des lieux, des fragments de vie ; et un travail constructif, qui échafaude depuis le dehors des mondes pluriels, des utopies concrètes et vivables. Mais au fond ne pourrait-on pas rétorquer cependant qu’à vouloir fragmenter le monde et destituer, on risque d’atomiser les luttes et de redoubler notre impuissance ? Comment donner de la consistance au « parti de la multiplicité », comment éviter qu’il s’éparpille tout en conservant sa multiplicité ? C’est une critique régulièrement formulée :
À partir du moment où plus personne n’est capable d’occuper une usine, un lieu de travail à fonction identifiable (et pas même une fac), […] l’espace se fragmente en une infinité de « ZAD » où chacun joue, dans l’entre-soi, sa partition, démocratique ou « subversiviste ». Ce morcellement, cette conjonction d’individualismes en action, cette attirance pour le non-ensemble, ce refus pathologique de toute centralité causale, cette fuite vers l’incertain et l’indéterminé, cette prédisposition au clanisme désirant, furent autant de caractéristiques de ce printemps [2016, contre la loi travail] qui ne pouvait accoucher d’aucun lendemain.9
Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que la logique destitutive ne pourrait déclarer une coupure nette avec le monde de l’économie sans s’exposer au risque de la marginalisation. Des assemblages bizarres, des alliances bâtardes entre institution et destitution (un pied dedans, un pied dehors) devraient être les plus efficaces. Mais nous sommes en quelque sorte contraints de suivre cette logique du fragment, car c’est bien de là que nous partons, puisqu’aucun sujet politique universel (le Parti, le Syndicat, le Prolétariat, le Travailleur, les Dominés) ne nous est donné a priori, qui plus est à l’heure où les anciennes unités se décomposent.
Cette esthétique de la lutte comme destitution va de pair avec une requalification de l’idée d’autonomie. L’autonomie n’est pas l’indépendance absolue d’un sujet émancipé des autres, seul maître de son monde et de sa vie. « L’autonomie, c’est la dépendance », nous disait Rafanell. Notre autonomie se joue certes dans « l’ouverture vers un dehors incompatible avec la capture et l’exploitation des formes de vie qui constituent l’intériorité capitaliste » (p.86), mais toujours dans une expérience collective, dans une communauté, ce qui mène nécessairement à des agencements bizarres entre de l’institutionnel et des formes d’autogestion, d’autosupport (comme par exemple l’école Maïa pour les autistes, la Parole errante, les ZAD, etc.) qu’il faut assumer comme tels.
Ce qu’il y a, ce sont différentes « lignes de fuite » hors du régime social de l’économie, qu’il nous faut composer. Le revers de la construction de l’ennemi est bien entendu la constitution d’un « camp des amis » (p.47) : la composition des mondes entre eux, à partir de ce qu’ils ont de commun, contre la composition des institutions capitalistes, qui disposent pour l’instant des plus puissantes forces, et contre les ennemis qui ne manqueront pas d’apparaître pour dénier la possibilité de ces nouvelles amitiés. Ce mouvement de composition fondé sur la reconnaissance d’attachements et d’appartenances multiples est primordial si l’on veut intégrer à la lutte des mondes qui comprennent aussi des non-humains (« dieux, ancêtres, animaux, artefacts techniques, biotopes et configurations géologiques. Il faut oser enfin altérer l’humanité du militant politique », p.61). Il indique également le besoin crucial d’évacuer tout purisme idéologique ou militant de mauvais aloi, la nécessité vitale de sortir « d’une posture qui voudrait que les amitiés politiques naissent du partage des idées » (p.88), pour partir plutôt de sensibilités communes, d’hostilités communes, à agencer sur un plan stratégique.
Quelle forme peut dès lors prendre cette composition ? C’est là qu’intervient sans doute l’idée la plus belle de cet opuscule : « une politique de l’enquête peut contribuer ainsi à l’instauration de nouvelles amitiés […]. Comme on dit, dans l’amitié, comme dans l’amour, on ne compte pas. On déambule, on se raconte nos histoires. » (p.65). On manquerait la charge politique du concept d’enquête à vouloir le rabattre sur l’enquête policière ou l’enquête théorique. Dans ces deux cas, l’enquêteur adopte une position neutre et reste imperméable à l’objet de son enquête, soit qu’il cherche à objectiver le récit d’un crime, soit qu’il prétende partir de phénomènes empiriques pour bâtir une théorie objective et séparée.
Pour Josep Rafanell, l’enquête n’est sans doute pas l’activité d’un enquêteur, mais l’activité d’un collectif, d’une pluralité de mondes où, si l’on veut, tout le monde enquête sur tout le monde. L’enquête désigne ici cette activité de co-constitution des mondes entre lesquels se créent des passages. Partager des expériences, fabriquer des récits collectifs, construire le parti de la multiplicité, cela demande un « travail interminable de traduction contre la représentation. Voir avec et non pas à la place des autres » (p.71). L’esprit de l’enquête s’incarne dans des dispositifs, c’est-à-dire dans des lieux et des collectifs qui sont des refuges pour se retrouver, des groupes d’autosupport, des ZAD, l’occupation de bâtiments vides avec des migrants10. Cette politique de l’enquête s’incarne aussi bien sûr dans la trajectoire même de Josep Rafanell, racontée dans la première partie d’En finir avec le capitalisme thérapeutique au gré de ses itinérances dans les prisons, dans l’Aide sociale à l’enfance, chez les toxicomanes, chez les Rroms, où il est moins question d’ « enquête » objective, sociologique, théorique, que de rendre sensible l’expérience des autres et de créer des amitiés. Aujourd’hui, ces enquêtes se multiplient par exemple autour des ateliers des Labos d’Aubervilliers et de la Plateforme d’enquête militante.
La tonalité fondamentale de ces processus d’enquête, de ces passages, de la mise en place de dispositifs, de toute cette « construction du camp des amis » c’est le soin. Il s’agit de prendre soin11 de la situation, des relations, des affections contractées, des hostilités communes, des lieux de rencontres, en ayant conscience que le monde commun et multiple de l’émancipation politique n’est jamais acquis mais toujours en voie de construction. Il faut pouvoir le chérir et travailler à sa puissance, car il ne correspond pas à un futur assuré, qui pourrait aussi bien être le cauchemar cybernétique de la surveillance et du contrôle généralisés, si ce n’est la guerre civile.
En somme : construire l’ennemi, le destituer, composer nos forces, travailler à notre autonomie. Voilà une série minimale de principes sur lesquels on peut s’accorder. Souvent, l’on reproche à cette conception des choses de décrocher complètement d’avec les luttes classiques sur les lieux de travail, dans les ONG, au sein des institutions. Ce serait à mon avis un faux procès, qui repose sur deux erreurs. Premièrement, il faudrait ne pas voir que ces luttes traditionnelles s’éparpillent d’elles-mêmes, se fragmentent, se désagrègent. Ne pas se poser la question de leur reconstruction serait s’acharner en vain. Deuxièmement, il ne me semble pas que la théorie de la destitution doive se payer d’un abandon des luttes institutionnelles ; mêmes ceux qui le voudraient ne pourraient pas se défaire immédiatement des institutions de ce monde, même pas dans une ZAD, où la bouffe vient encore pour partie du supermarché, où les enfants vont encore à l’école, où l’on va se faire soigner à l’hôpital. La sécession ne peut être d’emblée accomplie, elle est un processus, un processus de communisation. Pour son bon déroulement, il est nécessaire de tenir ensemble d’une part la politique d’enquête comme liaison et établissement de nouvelles complicités avec les luttes où qu’elles se situent (syndicat, travail, ONG, etc. : Blabla Grève, par exemple, est un projet prometteur !), et d’autre part, le souci constant de creuser l’entre-deux avec les institutions, en travaillant à notre autonomie.
Crédit photos : Agnes Toth
Cette histoire d’unification et de fragmentation du monde trouve une mignonne analogie chez les microtubules, des petits filaments cellulaires qui servent à la cellule pour se déplacer ou transporter des trucs. Les microtubules se forment par ajout bout à bout de fragments, qui sont menacés, après une certaine quantité d’accumulation, par le phénomène de « catastrophe », où tout se désagrège soudainement. Il existe néanmoins un contre-phénomène, appelé « sauvetage », qui corrige la catastrophe en cours et réassure l’unité.
Notes
| 1. | ↑ | Par « rapports humains », j’entends bien plus que « rapports entre humains », mais aussi tout ce qui lie les humains aux autres êtres qui peuplent leur vie, animaux, végétaux, minéraux, esprits, substances, âmes, morts. |
| 2. | ↑ | En fait, bien que ce texte de Josep Rafanell soit la matrice conceptuelle avouée de Maintenant, il convient de préciser qu’il est plus que cela, car il met décidément l’accent sur la valeur positive, affirmative du fragment, là où Maintenant brossait avant tout, dans le chapitre 2, le tableau décadent d’un monde qui s’éparpille et se divise (mais le chapitre 5, « Pour la suite du monde », est un joli contrepoint de Fragmenter le monde). On pourrait dire que Maintenant contient plutôt la pars destruens du thème de la fragmentation, et Fragmenter le monde plutôt la pars construens, si bien qu’une lecture simultanée des deux bouquins s’impose pour un panorama complet des possibles ouverts par ce thème. |
| 3. | ↑ | Comité invisible, Maintenant, pp.19-24 |
| 4. | ↑ | Sur le vivre-ensemble, voir ce très drôle article sur les « Assises nationales de la citoyenneté », sous-titrées « vivre ensemble », qui se tiendront à Rennes les 19 et 20 janvier prochain. |
| 5. | ↑ | Comité invisible, Maintenant, p.22 |
| 6. | ↑ | Ceci est déjà très bien dit dans L’insurrection qui vient du Comité invisible : « Ce que je suis ? Lié de toutes parts à des lieux, des souffrances, des ancêtres, des amis, des amours, des événements, des langues, des souvenirs, à toutes sortes de choses qui, de toute évidence, ne sont pas moi. Tout ce qui m’attache au monde, tous les liens qui me constituent, toutes les forces qui me peuplent ne tissent pas une identité, comme on m’incite à la brandir, mais une existence, singulière, commune, vivante, et d’où émerge par endroits, par moments, cet être qui dit « je ». Notre sentiment d’inconsistance n’est que l’effet de cette bête croyance dans la permanence du Moi, et du peu de soin que nous accordons à ce qui nous fait. » (p.15). |
| 7. | ↑ | « Se désintégrer« , Josep Rafanell i Orra |
| 8. | ↑ | Sur la multiplicité des natures, voir par exemple Armel Campagne, Le Capitalocène, Divergences, 2018, pp.55-61. |
| 9. | ↑ | Voir l’article « Misère du subversivisme« , qui critique Maintenant du Comité invisible. |
| 10. | ↑ | Lire par exemple « Le mouvement d’occupation contre les politiques migratoires continue » sur lundi matin. |
| 11. | ↑ | « Comme une variation de l’émeute : prendre soin » est le nom d’un très bel article de Josep Rafanell, que l’on peut consulter chez Lundi matin. |