En banlieue : défaire le mythe de la « radicalisation » (Fabien Truong)
Entretien autour du livre Loyautés radicales, l'islam et les "mauvais garçons" de la nation
En France, les banlieues ont toujours le mauvais rôle. Depuis les années 1980, la crise économique et l’imposition par le Front National du « problème de l’immigration », les « travailleurs étrangers » sont devenus les « immigrés », une catégorie à part, symboliquement détachée de la classe ouvrière, avec tous les stigmates que cela implique. La diabolisation des cités est aussi devenue la garantie pour média et politiques d’attirer une certaine audience inquiète et en colère en dénonçant la fracture nationale, la perte des valeurs françaises, la prolifération des voyous ou encore, dernier thème à succès en date, « l’islamisation » et la « radicalisation ». Derrière ces incantations se cache une réalité bien plus complexe dans laquelle les « banlieusards » tentent de s’en sortir face au manque de moyens, à la stigmatisation, à la perte de repères, bref face à une société qui ne les acceptent que sur les bords.
Ce sont ces parcours qu’a étudiés, sur place, le sociologue Fabien Truong, notamment afin de montrer pourquoi certains jeunes dans certains quartiers se tournent vers l’islam et le sens que peuvent prendre ces chemins, qu’ils soient « radicaux » ou, la plupart du temps, pacifiques et rédempteurs. Plutôt que « la radicalisation », des « loyautés radicales » donc. Une telle enquête est en même temps l’occasion rêvée pour nous de retrouver un début de contact avec ces destins toujours dans l’ombre, première étape pour qui voudrait reconstruire des solidarités.
G : Vous êtes professeur à Paris 8, c’est ça ?
FT : Oui c’est ça, avant j’ai été prof six ans en lycée en Seine-Saint-Denis. J’étais titulaire sur zone de remplacement, c’est-à-dire que je bougeais pas mal et que j’allais dans les endroits où les collègues ne se pressaient pas trop au portillon. C’est comme ça que j’ai découvert « la banlieue », sa jeunesse, ses quartiers. C’était en 2005, un moment où il se passait beaucoup de choses [les « émeutes de banlieue »]. Progressivement j’ai converti cette expérience en terrain d’enquête.
G : Vous avez écrit votre premier livre (Des capuches et des hommes) à partir de vos discussions avec d’anciens élèves, recontactés quelques années après la fin du lycée. Mais à la base vous n’aviez pas prévu de faire de la recherche sur vos étudiants ?
FT : Pas du tout. C’est l’insatisfaction par rapport à ce que je vivais et ce que j’observais qui m’a poussé à mener des enquêtes et à écrire. Comme remplaçant je « tournais » beaucoup en banlieue et voyais pas mal de situations qui se répétaient : les mêmes incompréhensions entre profs, élèves et j’avais envie de voir plus clair dans tout ça. Et en 2005, nombre de ces problèmes étaient incandescents. À l’époque, on entendait dans les média une parole qui venait de très haut, au point que ce qui paraissait être le plus honnête sur le sujet, c’était la littérature de profs qui racontaient leur quotidien avec leurs élèves, un peu comme dans Entre les murs. Il y avait des idées pas mauvaises, beaucoup de bonne volonté mais le regard porté restait ambigu et extérieur, du type « voilà qui sont ces jeunes dont on parle » et ne rentrait pas dans l’histoire sociale telle qu’elle était réellement éprouvée. On n’observait que la salle de classe – et à travers le prisme de l’enseignant et de sa propre histoire, avec tout ce que cela implique : un certain rapport humain, une certaine situation, un certain point de vue.
J’étais aussi plutôt insatisfait avec ce que disait une partie des sciences sociales sur la jeunesse de banlieue, qui ne correspondait pas du tout à ce que je vivais. Pour moi, il était urgent qu’on se déprenne de nombre de prénotions, à commencer par les miennes. C’est à ça que sert l’enquête sociologique : à la fois à entrer dans la complexité du réel, mais aussi à atteindre une certaine simplicité, parce que ce qui se joue dans la réalité est simplement plus humain que quand on ne regarde ce qui se passe que d’en haut. Et typiquement, seul quelqu’un cloîtré dans son bureau peut penser que tout est uniquement le produit mécanique d’une culture, d’une structure ou de l’air du temps…
J’ai commencé à travailler avec un double déplacement de focale : d’abord en regardant comment mes élèves étaient dans la salle de classe et comment ils étaient à côté, ce qui permettait déjà de comprendre beaucoup de choses ; deuxièmement je me suis concentré sur les parcours des jeunes dans le temps afin de suivre des trajectoires. À partir de là, je me suis intéressé à des thèmes très différents : la mobilité sociale, la délinquance, la réussite scolaire, puis ce qu’on appelle « la radicalisation » qui renvoie en partie à la question de la violence et à ses conséquences politiques. Avec le recul, je m’aperçois que je discute avec des collègues qui ont parfois des domaines de spécialité très différents et je m’en réjouis : je me méfie toujours du cloisonnement dans le champ universitaire. Je m’intéresse moins à des objets qu’à des situations, ce qui implique aussi de suivre le terrain là où il mène.
Si intellectuellement, on considère « la banlieue » comme une forme de périphérie, il faut se rappeler que sans le centre elle n’existerait pas et vice-versa. C’est pour ça qu’il ne faut pas la traiter comme “un problème” ou un objet “à part ». Ce qui se joue dans les banlieues, c’est ce qui se joue au centre, mais souvent de manière exacerbée et plus radicale. Les cités nous disent beaucoup de choses sur toute la société française. Ce que j’explique par exemple sur l’entrée dans la religion ou les conséquences de l’exposition durable et prolongée à la violence, ce sont des choses produites par notre société et qui ne viennent pas de « l’extérieur ». Pour cela, quand on parle du « communautarisme » des garçons se revendiquant musulmans, c’est souvent du fantasme, soit parce qu’on ne voit pas ce qui se passe à hauteur individuelle soit parce qu ’on ne creuse pas sous les mises en scène de soi qui sont prises pour argent comptant. En fait, dans la façon dont se fait l’entrée effective dans la religion (la conversion), on observe plutôt un acte singulariste, individualiste, où chacun veut inventer à soi-même sa propre religiosité et bricole avec les divers éléments de sa biographie qu’une procédure uniforme et collectivement structurée. Par dessus ces éléments, il y a la mise en scène d’un renouveau et d’une rupture autour d’une vision imaginaire de la « communauté ». Ce qui renvoie plus aux injonctions de la modernité à être soi-même, gouverner sa propre vie ou devenir meilleur que les autres qu’à une plongée totale au sein d’une communauté hyper organisée.

L’étape de conversion qui peut-être excessive et agressive, ça ne dure pourtant, dans l’écrasante majorité, qu’un temps. On ne peut pas vivre sa vie en étant à la fois novice [celui qui vient de se convertir et est, généralement, le plus enthousiaste tout en n’y connaissant pas grand chose] et en pensant être le meilleur car tu es régulièrement démasqué et tu te fâches avec beaucoup de monde ! Ce qui est intéressant, c’est le temps long, celui de ce que j’appelle la « reconversion », c’est-à-dire la manière dont la religion trouve graduellement sa place avec le reste dans ton existence : elle est contextualisée avec la biographie, le monde environnant. Le spectacle de la conversion laisse place à une religiosité qui s’intègre dans l’ordinaire de la vie…
Le piège que nous tend Daesh, c’est la décontextualisation. Il nous propose un imaginaire politique flottant. Autrement dit, un imaginaire politique qui est détaché du réel mais qui fonctionne, puisque notre société peine aujourd’hui à fournir une narration qui donne du sens politique à l’existence. Une fois qu’on a dit ça, il n’y a pas cinquante-six façons de contextualiser : il faut aller voir ce que font les gens, prendre le temps de les comprendre ; c’est ça, au fond, l’enquête.
G : Ça me fait penser que quand il y avait eu les attentats de 2015, j’étais allé voir les vidéos de revendication postées par Daesh. Ils disaient qu’ils voulaient viser les « zones grises », c’est-à-dire les zones urbaines où il y avait encore de la mixité sociale, ethnique, religieuse, du contact et des conversations, une résistance à la ségrégation. En somme, il s’agissait de jouer le jeu de l’exclusion et des discriminations pour exacerber les tensions. Finalement, vous diriez que quand on ne va pas sur le terrain et qu’on transmet des clichés sur les « jeunes de banlieue », la « radicalisation » et les populations racisées, on ne « combat » pas du tout le « terrorisme » mais au contraire on le revigore ?
FT : Il ne faut pas être trop caricatural et tout mettre sur un même plan : un discours n’est pas une fusillade. Mais au niveau symbolique c’est clair que le pendant du terrorisme, ce sont les discours stéréotypés qui produisent de la ségrégation et discriminent. Quel est le rapport entre les discours et les pratiques : c’est une vraie question et c’est très compliqué… ! Quand Gilles Kepel parle de « radicalisation de l’islam », intellectuellement il entend que les textes et l’idéologie autour de l’islam se sont durcis, et qu’à cause de cela les gens deviennent plus durs. On peut sûrement débattre du fait que la vulgate islamiste se soit durcie, même s’il y a beaucoup de gens qui trouvent la position de Kepel sur ce point caricaturale.
Mais même si on accepte cette idée, qu’il y ait une certaine partie de l’interprétation des textes islamiques qui se soit durcie et idéologisée de manière radicale, la prémisse qui laisse penser que parce que les discours sont plus radicaux, les gens vont devenir plus radicaux, c’est de la vieille science politique des années 30. C’est un peu le modèle de Harold Lasswell avec le modèle de la « piqûre hypodermique ». Ça consiste à dire que les média ou les leaders politiques injectent directement leurs messages dans le corps social (comme le ferait une seringue dans le corps humain). En bref : on considère les gens comme des pantins. À l’époque, toutes ces théories sont nées avec la peur panique du communisme, autrement dit, autour d’une vision moralisée et simpliste de la réalité.
C’est la même chose avec Daesh, la vraie question n’est pas tant celle de la radicalisation concomitante des discours et des pratiques mais : à quoi ce qu’on appelle « radicalisation » répond ? Pourquoi des discours plus durs prennent chez certains individus et font sens? Et pour y répondre, il faut s’attacher à du concret : si un islam « dur » prend, c’est qu’il produit des ressources, qu’il offre des perspectives dans un contexte social particulier.
À partir de là, que disent les discours sociologisants un peu éloigné du terrain? Ils affirment que l’islam donne du sens en fournissant un « sentiment d’intégration », ce qui n’est pas absolument faux mais qu’est-ce que c’est plat ! La réalité est beaucoup plus fine et intéressante : l’islam répond à des questions métaphysiques, spirituelles, esthétiques, intellectuelles, politiques, morales. La question de la souillure, par exemple, se pose vraiment avec force.
Les garçons de cité qui sont coincés dans la « seconde zone » (un espace de relations et de représentations spécifiques qui sanctionnent le fait de vivre à l’écart, dans et par l’illégalité et l’économie parallèle qui ne concerne qu’une petite partie des garçons mais qui s’est pour autant aujourd’hui bien implanté) ont souvent perdu des potes de mort violente, alors qu’est-ce qu’ils font avec ça ? Pour faire son deuil, il faut un travail. Et quand tu n’as pas d’instances de socialisation qui organisent ce travail, à part quelques éducateurs qui bien souvent sont trop isolés, on se retrouve vite tout seul sans réponse. Au niveau esthétique aussi, la plupart de ces jeunes font une expérience de la laideur particulière qui est profondément ancrée ; si on ne propose pas un espace pour travailler tout ça, la religion devient l’unique recours. S’il n’y a pas d’autres réponses possibles proposées à toutes ces questions – et ce pour différentes raisons liées à l’histoire des quartiers populaires- la religion devient un médium très puissant.

Ces différents problèmes qui se posent aux jeunes de cité viennent ainsi de l’intérieur de la vie sociale. On voit bien alors pourquoi la « radicalisation » est le produit de nos sociétés et pas d’une abstraction : l’Islam, l’Orient ou je ne sais quoi. Après, reste toujours le niveau de l’exploitation symbolique de ces problèmes et du sentiment d’injustice: d’une part la symbolique orchestrée par Daesh, c’est-à-dire l’opposition absolue entre le Musulman et le Mécréant, d’autre part celle sur laquelle surfent certains politiques qui croient que la riposte doit passer par la réaffirmation sonnante et trébuchante de « l’identité nationale ». Mais prendre ces effets symboliques pour argent comptant, c’est trompeur. La croyance dans le plein pouvoir de l’idéologie et du discours, c’est un truc de salon.
G : En gros l’apport de la sociologie, c’est de montrer que la religion est un exercice de soi ou une pratique communautaire comme un autre ? Et que de ce fait, c’est tout à fait encastré dans la société ?
FT : Je montre que la religiosité, c’est un médium. Autrement dit, « la religion » n’existe pas toute seule ; il s’agit toujours d’une interprétation de textes dans un contexte donné, à une époque définie. Et ensuite d’une série d’écarts entre l’interprétation et les actions. A minima ce qu’on devrait faire face à l’épreuve que nous impose le terrorisme, c’est de ne pas tomber dans le piège de la décontextualisation mais de comprendre. Quand le premier ministre [Manuel Valls, en 2015] dit que « comprendre, c’est excuser », on est exactement dans ce que veut entendre Daesh. Au contraire, si on commençait vraiment à comprendre, premièrement on montrerait qu’il est possible que d’autres institutions puissent répondre aux questions et conflits que résout aujourd’hui la religion ; deuxièmement, cela nous mettrait le nez là où sont nos vrais problèmes et nos vraies contradictions. Et pas celles que Daesh nous vend… à distance.
Quand on essaye de comprendre, les choses deviennent souvent moins dramatiques que ce qu’elles paraissaient au premier abord. Si tu prends l’exemple de Radouane dans mon livre, c’est quelqu’un qui envisage de partir en Syrie, c’est pas rien. Il se dit prêt à aller mourir pour l’Islam. En même temps, quand il part faire le Hadj (le pèlerinage à la Mecque, l’un des cinq piliers de l’Islam), il revient et commence à tenir un discours presque à la Marine Le Pen : « Nous les Français, on est quand même plus propres et plus civilisés que les musulmans des autres pays ! », eh bien il fait exactement l’épreuve de la contextualité. En se déplaçant, il a compris à quel point il était, d’une certaine façon plus « Français » que ce qu’il croyait…
G : Contre les gens qui disent que « comprendre, c’est excuser », en lisant ton bouquin on a presque l’impression que comprendre, c’est déjà avoir une action sur le réel. Par exemple, je me souviens qu’un de tes enquêtés avait lu ton bouquin et disait que ça faisait longtemps qu’il avait pas lu un bouquin aussi long.
FT : Le lien entre la compréhension et l’action est essentiel. C’est un chemin assez incertain mais ce qui est sûr, c’est que les conséquences directes de l’incompréhension sont terribles: ça se voit par exemple dans les politiques de « déradicalisation » qui ont été mises en place dans l’urgence. On dit qu’il faut « produire du contre-discours ». Voilà la conséquence des idées de Gilles Kepel : il y a une idéologie, donc il faut produire une contre-idéologie. Alors on fait des clips qui sont un peu pathétiques. Face à des ados qui « mordent à l’hameçon », ce message il veut dire : « les gars, vous êtes des débiles, reconnaissez à quel point vous êtes faits berner et arrêtez de penser comme ça. » Pour des gens qui sont saisis par l’imaginaire politique flottant de Daesh, il n’y a pas pire que ce type de plaidoyer. En fait, c’est presque de la prophétie auto-réalisatrice dans certains cas. Cela contribue à donner de la chair et du sens à la division : « c’est vrai qu’il y a eux et nous, regardez comment eux ils pensent et ce qu’ils pensent de nous ». Autant ne pas dépenser de l’argent dans ce type de campagne, il serait sans doute plus utile de l’utiliser pour favoriser les pratiques artistiques au collège !! Ou introduire un un véritable accompagnement psychologique des gamins qui perdent un pote… En somme, ce type de vision de la « déradicalisation », renvoie à des fantasmes imaginés par des gens qui sont loin de ce qu’ils dénoncent, mais ça a des conséquences concrètes.

G : Ça consiste en quoi le déplacement que tu opères en ne parlant plus d’islamisation de la radicalité ou de radicalisation de l’islam mais de « loyautés radicales » ?
FT : Penser ce qu’on appelle « radicalisation », plutôt en terme de « loyautés radicales » ça veut dire plusieurs choses. Premièrement : il s’agit de remarquer qu’une spécificité des quartiers populaires et des cités, c’est de fabriquer des conflits de loyautés. Pourquoi ? Parce que mécaniquement la configuration sociale des marges produit des tensions et de la conflictualité. Plus précisément, cela signifie que les jeunes garçons (pour ne prendre que ce dont je traite dans mon dernier livre) se mettent en scène de manières très différentes selon les gens avec qui ils sont : tu parles différemment à des équipiers de business, à des rivaux, à des copains de la même génération mais qui sont pas dans le business, à des plus grands, à des plus petits, à des jeunes qui sont pas du quartier, à des profs, à ta petite copine officielle, aux petites copines cachées si tu en as, à ton père, à ta mère, etc. Il y a beaucoup plus de coupures que dans d’autres univers sociaux, du fait de ce que vivent ces jeunes-là. Tous ces conflits de loyautés (ces réseaux d’injonctions contradictoires) doivent être résolus d’une manière ou d’une autre. Dans ce contexte, la religion est assez puissante puisqu’elle permet de donner un simili de cohérence ; en tout cas c’est ce que manifeste l’idée qu’on s’en fait quand on la voit comme un moyen de mettre de l’ordre dans son existence.
De ce point de vue, l’entrée dans la religion permet par exemple de régler les conflits de génération : quand les jeunes garçons disent à leur père « je suis un meilleur musulman que toi », en fait ils sont en train de dire « Papa je serai pas comme toi. Tout ce que t’as enduré, toutes les souffrances que tu as vécues, et bien parce que j’ai pas réussi à répondre au contrat tacite de la famille qui consistait à réussir à l’école, je les refuse et je vais m’affirmer moi, je vais affirmer ma virilité. Mais c’est aussi dire: tu vois moi aussi je suis musulman, donc je suis un peu comme toi. » Quand pères et fils vont à la mosquée le vendredi, ils ne se parlent pas, n’y vont pas avec les mêmes personnes mais ils sont dans la même pièce et partagent quelque chose. Il faut se rendre compte qu’en règle générale, on se parle très peu entre père et fils, et la religion c’est une façon de communiquer. C’est une façon de dire : je t’aime.
Autres conflits auquel répond la religion : les questions esthétiques (comment on introduit du beau, une espèce de transcendance dans son existence), les questions intellectuelles (le rapport à l’école)… Dans une certaine mesure, rentrer dans la religion c’est essayer de retrouver un rapport intellectualisé au monde, c’est-à-dire un rapport de compréhension et de mise à distance par rapport à tout ce qui arrive (les souffrances, la domination, etc.). La religion permet aussi de rejouer son passé scolaire parce que le Coran c’est un livre. Autrement dit, un des objets culturels les plus légitimes dans notre société. Le lire, ça permet de construire un rapport au beau, de retrouver une certaine intelligence du monde,.
De même, la religion permet de résoudre un problème politique, celui de la projection dans une communauté organisée collectivement. Les garçons qui sont coincés dans la seconde zone de la délinquance sont en un certain sens les produits du système capitaliste, à l’envers : ce sont des super-managers obsédés par l’accumulation matérialiste, mais ils sont dans l’illégal. Un moment donné il y a une perte de sens, parce que courir après l’argent avec chaque nouveau projet de deal, recel, braquage, c’est vide et c’est éreintant.
Prenons ce cas précis des « délinquants ». Pour être clair, la norme dans les cités pour les garçons qui entrent dans la petite délinquance, c’est plus tard d’en sortir. La délinquance, c’est le plus souvent quelque chose de transitionnel. Mais il existe aussi une partie très minoritaire de jeunes qui sont coincés dans la seconde zone. Le souci, c’est que cette partie est en train de devenir de plus en plus importante. Pour ces jeunes, il y a des choses extrêmes qui se jouent alors en terme de violence envers soi-même et envers les autres ou de haine de soi. La religion est alors envisagée comme une solution potentielle à des conflits de loyautés : elle permet de se laver symboliquement. Ainsi, la question n’est plus « en quoi l’islam est un problème » mais devient : qu’est-ce qui fait qu’il y a des gamins qui restent coincés dans la seconde zone et pour lesquelles la seule alternative est l’islam ?
Pourquoi « loyautés radicales » alors ? Comme on le voit, toutes les questions que j’ai soulevées renvoient à un rapport de loyauté par rapport à notre société, ses récits collectifs et ses injonctions. Les interrogations que travaillent les jeunes de banlieue sont simplement plus radicales puisque leur exposition aux contradictions de notre système est plus incisive. Il suffit de comparer le rapport à l’islam que j’analyse dans mes enquêtes et celui qui transparaît dans d’autres pays, tu te rends compte qu’il y a quelques points communs mais surtout beaucoup de divergences. Ça montre que la religiosité n’est pas décrochée du contexte social, quoi qu’on en dise. C’est cela qui rend la comparaison intéressante. La comparaison avec les Etats-Unis est intéressante parce qu’on voit que là-bas la liquidation de la seconde zone se fait de manière différente, dans une guérilla urbaine dans laquelle les noirs paient un lourd tribu.
Ce que je montre aussi dans mon bouquin, c’est que le chemin le plus habituel est aussi celui qui est le plus invisibilisé : la voie de la pacification par l’intermédiaire de la religion. La religion fait le job principalement parce qu’il n’y a pas grand chose d’autre, mais aussi parce que le rapport à la religiosité est une voie alternative crédible pour ceux qui refusent d’en rester à une vision belliqueuse qui intime de régler les choses par le sang.

Il faut bien garder en tête que les deux voies, celle de la pacification et celle de la « radicalisation », existent : les idéologues essayent souvent de n’en garder qu’une seule. Le débat, pour eux, a pour but de déterminer si l’islam c’est bien ou c’est mal. Mais il faudrait aussi poser la question des filets de sécurité matériels et moraux qui retiennent de tomber dans un engagement vécu sous le mode de l’affrontement: avoir un appartement, une copine, un boulot… Ça paraît cliché mais c’est essentiel. Cette satisfaction à laquelle tout le monde aspire dans notre société, avec un équilibre entre accumulation matérialiste et dépossession altruiste et des arrangements pas toujours très spectaculaires, c’est ce qui joue comme filet de sécurité. Ces garçons ont juste moins d’arrangements possibles et de capitaux accessibles. La religion en offre d’autres, et il faut donc bien voir cette dimension dans l’acte de foi qui a peu à voir avec la seule idéologie.
G : Tu observes qu’il n’est plus possible de penser la conflictualité en banlieue en termes de luttes des classes et tu inventes le principe du chacun-pour-soi de classe. En quoi ça consiste ?
F : Au XIXè siècle, Marx distinguait classe en soi et pour soi. En gros, on était dans un moment historique où, selon la théorie, les individus n’avaient pas encore compris qu’ils avaient des intérêts communs à lutter ensemble et qu’ils gagneraient logiquement s’ils le savaient, car ils représentaient le nombre. Le problème était donc celui de la subjectivation ouvrière (prise de conscience des intérêts concrets sur lesquels fonder la révolution).
Ensuite il y a eu un autre moment historique, des années 1950 à 1970. Celui qui parle le mieux de ce qui s’y joue, c’est Richard Hoggart. Il développe de longs passages sur le fatalisme ouvrier, à savoir l’idée que la classe ouvrière avait « accepté son destin ». Mais en parallèle, les ouvriers avaient une conscience aiguë du fait qu’ils formaient un nous en face d’un eux, ils savaient qu’ils partageaient un destin commun face au eux, mais eux justement, on ne savait plus précisément qui c’était (contrairement au capitaliste du XIXè siècle). Le eux du temps d’Hoggart, c’est abstraitement tous ceux qui ont du pouvoir : profs, patrons, managers. En un sens, les ouvriers s’en sortent d’une certaine façon de cette manière : ils ne sont pas dupes, ils peuvent prendre une certaine distance par rapport à leur destin, ils peuvent se foutre de la gueule du eux très ironiquement. Il y a sans doute un côté un peu british mais cette mise à distance oblique est assez fine, on n’est ni dans ce que que Passeront et Grignon ont appelé le misérabilisme ou le populisme mais bien ailleurs.
Actuellement, le monde des ouvriers (et des employés qui ont des conditions similaires) est beaucoup plus disparate et dispersé. Le travail est éclaté, la fierté de classe a disparu, la fierté d’être ouvrier n’existe plus vraiment. Cela tient aussi au fait qu’il y a eu une vague d’immigration dans laquelle les migrants étaient infériorisés à l’usine, ils perdaient le statut qu’ils avaient au pays, ils fermaient leur gueule. En grande partie, ce sont leurs enfants qui sont maintenant ouvriers alors que les parents rêvaient d’autre chose. Ils ont un rapport au groupe qui est complètement différent à celui analysé par Hoggart.
Il me semble justement que ce qui se joue dans les banlieues c’est une nouvelle configuration du rapport entre individus, groupes et transformations politiques. La pleine conscience qu’on y partage une condition commune est vive. Depuis 2005, « tout le monde » parle des banlieues et tout le monde en parle en mal. Ceux qui habitent en banlieue apprennent donc en tant qu’ado et jeune à se construire à l’envers et contre le regard des gens qui n’y habitent pas. Ainsi, la conscience du eux et du nous est très forte.
Par contre on n’est plus dans la logique qui consistait à rester dans le groupe en regardant les choses à distance et en acceptant sa position. L’enjeu aujourd’hui c’est de s’échapper de la cité. De ce point de vue-là, si tu regardes les statistiques, la banlieue fonctionne un peu comme un sas. Des jeunes grandissent en banlieue et ils partent. La mobilité sociale résidentielle existe et elle est plutôt forte par rapport à d’autres territoires. Quelque part, c’est à l’honneur de la France. Mais toute une partie des gens sont aussi complètement bloqués. Ça a commencé dans les années 50, et ce sont des gens qui voient d’autres personnes arriver et repartir tout en restant eux-mêmes coincés. Comme la frustration est relative et se mesure par rapport à ce qu’on observe chez les gens qui nous ressemblent, là elle augmente.

Ce qui paraît nouveau aujourd’hui, c’est que pour les classes populaires, qui sont aujourd’hui très fragmentées, il faut s’en sortir mais s’en sortir individuellement. Mais en combattant personnellement contre l’adversité, on lutte aussi contre la défiance que la société porte sur tout un groupe (« fille ou fils d’immigré, aucun moyen que tu réussisses »). La conflictualité est donc en même temps individuelle et collective (il faut réussir et rester proche de « ses racines »). Sinon je n’aurais pas parlé de chacun-pour-soi de classe – c’est un combat personnel mené au nom du monde qu’on partage avec « les siens ». Un groupe difficile à définir car la domination prend aussi des formes multiples, « intersectionnelles » comme on dit, et qui, je crois, accentue le sentiment de devoir mener un combat individuel.
Bien que ce soit des trajectoires très différentes, je crois qu’on retrouve des choses un peu parallèles chez l’étudiant qui se « sort » de sa cité et ceux qui sont attirés par le djihadisme, dans cette idée d’avoir à se battre seul pour l’honneur des siens. C’est que les étudiants ont un devoir de réussite qui est un mandat collectif : quand tu viens de cité et que tu vas à Sciences Po, tu représentes aussi les tiens et tu te bats contre les bien-nés pour faire ta place. Il y a quelque chose de l’ordre de la cause commune dans le fait de devoir gagner sa place, mais de manière floue et flottante. La notion de retour par exemple est forte : les jeunes qui s’en sortent qui reviennent dans les quartiers faire des cours du soir, ils se sentent redevables. C’est un peu la même chose qui attire vers Daesh, vers la lutte en Syrie : dans ce cas, l’existence d’une cause commune devient littérale puisqu’on leur dit « vous allez vous sortir de la cité pour vous battre pour la cause musulmane ».
Ce qui est clair, c’est que quand on dit « les musulmans » c’est largement du fantasme. Tout le prisme musulmans/non musulmans ou même les blancs contre les non-blancs, comme dirait Jean-Claude Passeron, « c’est même pas faux ». C’est « pas faux » mais terrible et réducteur de réduire le réel à ce « pas faux ». Est-ce que la fragmentation des communautés c’est blancs contre non-blancs ? Est-ce que c’est pauvres contre riches ? Musulmans contre chrétiens ? Banlieusards contre familles du centre-ville ? Tout ça est mélangé : il y a des stigmates territoriaux, des capitaux inégalement distribués, de la stigmatisation lié à la couleur de peau, au genre, etc. C’est toujours un mélange et c’est pour ça que c’est compliqué.
Quand un étendard essaye de mobiliser au delà de la rhétorique du chacun-pour-soi de classe en rendant prégnante une cause commune englobante, ça peut prendre un temps mais je doute que cela puisse avoir un débouché politique possible à terme. Les « indigènes » contre la « République », les blancs contre les non-blancs, ça ne marchera jamais au delà d’un certain cercle. Parce qu’une fois que t’as réuni un groupe de personnes qui se reconnaissent dans une vision du monde binaire, tu vas vite te rendre compte que, par exemple, le monolithe des blancs comme celui des non-blancs est en fait très divers : certains sont plus bourgeois que d’autres, il y a des différences de lieux de vie, etc. ; alors au bout d’un moment le bloc s’effrite.
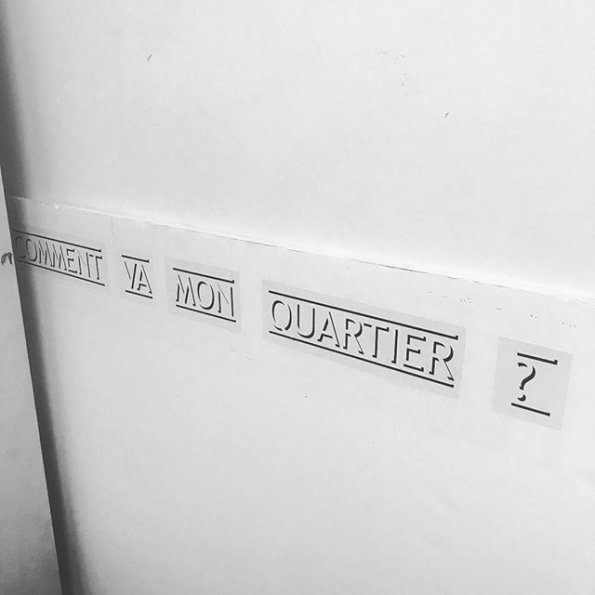
En fin de compte le chacun-pour-soi de classe permet de rendre compte de cette fragmentation que j’observe et de sortir du fantasme de l’hyperindividualisme, c’est-à-dire de l’idée que qu’il n’y aurait plus de représentation en terme de groupes – ce qui est complètement faux. D’un autre côté, il faut aussi sortir du fantasme selon lequel la victimisation dans les banlieues va finir par provoquer un grand soir, une révolution. Il y a là une erreur de diagnostic. C’est un peu radical chic. Ces jeunes, ils ont des désirs politiques et de changement, mais l’urgence c’est d’avoir le même appartement que quelqu’un de « bien né ».. Qui est prêt à lâcher son appart ? Ça c’est une vraie question.
G : Sur le terrain comment on pourrait penser les voies par lesquelles les luttes s’articulent, il me semble, politiquement, par exemple dans les mouvements comme « Vérité pour Adama » ?
F : Le rapport entre police et jeunesse, ça c’est un combat politique urgent et mon enquête objective assez bien ça. Il y a aussi des déterminations structurelles importantes sur ces questions de violence sur la voie publique. Le fait qu’il y ait de plus en plus d’armes dans les quartiers par exemple, c’est une conséquence de l’effondrement des blocs de l’Est… Il faut faire le calcul : quand tu peux choper une kalashnikov pour 400-500 euros, et que dans un four (lieu où s’opère le deal) tu peux faire, en recoupant les rumeurs et selon le type de produits vendus, entre 4000 et 10 000 euros par jour grosso modo, c’est pas étonnant que tu t’y mettes à y penser aussi. Le problème de la circulation des armes est d’une urgence très actuelle. Ca altère par exemple le rapport entre les “grands” et les “petits” dans les quartiers, et donc des modes de socialisation et de remédiation qui avaient leur logique et qui sont mises à mal.
Le défi pour reproduire du commun c’est de pouvoir créer des catégories politiques qui soient transversales (et qui optent donc pour un langage aussi transversal) mais qui prennent en compte la question centrale qui est celle des inégalités produites et subies dans le système. L’approche marxiste avait pour elle l’avantage d’une ligne économiciste transversale. Mais après, avec la décolonisation et tout le reste des fragmentations à l’œuvre, cette seule ligne n’est plus possible. Donc c’est un défi politique. Je pense qu’il n’existe pas une telle offre aujourd’hui et qu’elle a d’autant plus de mal à émerger que, comme on est dans des sociétés qui sont de moins en moins mixtes socialement, les jeunes grandissent quand même de plus en plus longtemps séparément les uns des autres. Cela n’aide pas à produire des perspectives communes et inédites.

G : Du coup, les mots d’ordres du type « convergence des luttes » peuvent n’être pas assez concret pour rassembler vraiment ?
FT : Quand l’engagement se fait sur des trucs très concrets, ça peut vraiment avoir un impact, comme lors du mouvement pour Adama. Je pense qu’il faut se fixer des objectifs concrets pour que ça fonctionne, parce que ce sont les engagements concrets qui ont marché ces derniers temps. Les violences policières sont très concrètes, donc les luttes ont un écho. Idem avec “balance ton porc”. Peut-être est-ce un peu insatisfaisant d’en rester à des points spécifiques, mais c’est toujours mieux que ce que proclament les tribuns de Saint-Germain. Après les objectifs restent de l’ordre de l’aménagement : même si on arrive à faire en sorte que la police soit, au sens étymologique, plus intelligente, c’est un aménagement du système, pas une révolution.
G : Je reviens sur l’islam. Foucault pensait que la révolution iranienne de 1979 avait été une révolution alimentée par l’islam et il parlait de « spiritualité politique ». Tu penses que l’Islam aujourd’hui peut être une force de mobilisation politique ? Qu’est-ce que tu penses de cette analyse en terme de « spiritualité politique »?
FT : En France, Zemmour et compagnie ont peur que l’islam devienne une force politique, mais c’est parce qu’ils nagent en plein délire. Aujourd’hui, cela paraît très improbable. Ce qui pourrait éventuellement changer les choses, c’est une victoire de Marine le Pen, mais on n’en est pas encore là. Les musulmans en France ont des pratiques et des intérêts divers. Il n’y a pas d’espace politique musulman. Dans d’autres pays je ne dis pas que l’islam ne structure pas le champs politique – comme potentiellement toutes les religions, l’histoire l’a bien montré. La religion peut charrier un imaginaire politique très puissant parce que c’est un acte de foi, et à un moment donné quand tu es dans la croyance tu peux aller « jusqu’au bout » ou être particulièrement bien contrôlé. On pourrait aussi sans doute aussi dire que ce qui a permis qu’un moment donné la République se maintienne en France c’est qu’il y a eu, pendant plusieurs générations, une vision un peu religieuse de la République : des républicains étaient prêts à mourir pour la République puisqu’ils « y croyaient ». Le politique se nourrit d’un credo.
Les photos sont toutes issues de l’instagram de Fabien Truong : https://www.instagram.com/fabientruong/




