Contre la machine capitaliste (Jean Vioulac)
Entretien avec Jean Vioulac, autour de la technique, du capitalisme et de la cybernétique
S’il y a une force de la philosophie, c’est qu’elle refuse les vulgates qui tentent de définir opportunément le monde. Cette force nous en avons besoin plus que jamais face au baratin latent sur la « nécessité » de s’adapter au marché, l’impossibilité de mener une politique révolutionnaire, les bienfaits de la technologie ; ce bref soupir qui résume notre époque à un triste « c’est comme ça, faites avec ».
Un apport critique permet de dynamiter les platitudes, de souligner l’importance souvent dramatique des changements contemporains, notamment en les inscrivant dans une histoire du rapport des hommes à leur monde. Celui du philosophe Jean Vioulac s’inscrit dans cette perspective et s’attache à montrer les spécificités de nouvelles formes d’aliénation propres au dispositif capitaliste. Et qu’on ne l’oublie pas : expliciter ce à quoi engage la forme du système dans lequel on vit, c’est aussi ouvrir des perspectives sur d’autres mondes.
Nous avons interrogé Jean Vioulac à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Approche de la criticité (PUF, 2018).
Comment diriez-vous que ce nouveau livre, Approche de la criticité, s’inscrit dans votre parcours livresque ?
En réalité, c’est toujours la même question : comprendre l’époque qui est la nôtre, avec cette hypothèse de départ que la révolution industrielle est la deuxième grande révolution dans l’histoire de l’humanité. La première, c’est la révolution néolithique. Avec ces deux révolutions, on a deux véritables séismes, qui font basculer l’humanité d’un état à un autre, et qui la redéfinissent dans toutes ses dimensions. La révolution néolithique a fait passer l’humanité de la préhistoire à l’histoire, de même aujourd’hui on est en train de passer de l’histoire à la post-histoire. Parler de fin de l’histoire, ça ne veut pas dire qu’il ne se passera plus rien, c’est reconnaître que l’histoire est un phénomène limité, relativement récent. Homo sapiens a plus de 100.000 ans, l’histoire a 10.000 ans. Pendant plus de 90.000 ans, homo sapiens était dans un mode de temporalité qui n’était pas l’historicité, dans un autre rapport au monde, une autre façon de faire communauté, etc.
Donc, le phénomène qui se passe maintenant, quand on est train de passer de l’histoire à la post-histoire, c’est une rupture de même envergure, et même de plus grande envergure en raison de sa rapidité. La révolution néolithique, c’est un processus qui a commencé dans la zone du Proche-Orient, et qui a mis 3000 ans avant de gagner le bassin danubien. De même, les zones de néolithisation en Méso-Amérique ou en Chine ont mis beaucoup de temps à s’étendre. Ceux qui ont vécu la néolithisation ne s’en sont pas rendus compte (même si on en trouve trace dans l’Ancien Testament : la sortie du jardin d’Eden, c’est le passage du paléolithique au néolithique). Nous, on voit les bouleversements à l’échelle d’une vie d’homme : en une vingtaine d’années, Internet a profondément révolutionné les rapports sociaux, le rapport au savoir, le rapport au monde. Les bouleversements qu’a connu l’humanité en deux siècles ont été fulgurants.
L’enjeu c’est de comprendre ce qui se passe, avec cette idée que ça concerne la philosophie au premier chef, parce que ce qui se passe, c’est un processus de rationalisation et de logicisation du monde. Ça concerne la philosophie parce qu’historiquement, la rationalité universelle, formelle et abstraite, de la pensée logique mathématique, est de provenance spécifiquement grecque ; l’histoire de la transmission de la rationalité scientifique, c’est l’histoire de l’héritage grec, et les Grecs ont nommé « philosophie » cette quête d’une totalité rationnelle, d’un savoir totalement rationnel d’un cosmos rationnel. Le processus en cours, c’est un processus de logicisation, d’intégration de la réalité dans une totalité purement numérique, dans une sphère purement logique, c’est l’assouvissement du désir de Platon.
Aujourd’hui, on vit dans un monde intégralement platonicien. Le cyberespace, c’est une nouvelle dimension, purement logique, numérique, atopique et utopique, qui s’est ajoutée à notre monde, c’est le « lieu intelligible » de Platon, où tout existe sous forme de code : toutes nos machines servent alors à phénoménaliser ces entités abstraites en les faisant apparaître sur des écrans, voire à les matérialiser avec les imprimantes 3D. Donc là, l’idée de Heidegger, celle d’un accomplissement de la métaphysique dans la technique, trouve sa confirmation. De même pour l’informatique : l’invention de l’ordinateur, c’est le moment où une logique purement objective et formelle, celle inventée par Leibniz, va trouver un point de contact avec le monde matériel. L’informatique, c’est ça : c’est quelque chose de purement mathématico-logique qui va avoir des effets réels dans le monde. Donc avec l’informatique, on a en quelque sorte la connexion entre le monde sensible et le monde intelligible, le monde intelligible qui va pouvoir gouverner directement le monde sensible.

Donc, si je reprends, il y a d’une part cette idée que notre époque est une époque de mutation sans précédent, que cette mutation se caractérise par des processus de rationalisation intégrale, de logicisation, de numérisation, et d’autre part que la raison qui est en cours de réalisation dans le monde, c’est celle qu’ont pensée les Grecs. C’est pourquoi penser notre époque, ça relève de la philosophie.
Nous approchons donc historiquement d’un moment critique. Or, vous mettez beaucoup de choses derrière le mot « crise » (économique, démographique, écologique, technologique, métaphysique, etc.). Est-ce le processus de rationalisation du réel dont vous parlez qui fait l’unité de cette crise ? D’autre part, pourquoi ce processus a-t-il un caractère péjoratif pour vous ?
Oui, l’unité c’est celle-ci : la logicisation du monde, l’avènement du logos [raison], la soumission du monde à sa logique. Toute la question devient alors celle du statut qu’on va donner à cette raison. Si on définit l’homme comme un pur esprit, un pur être de raison, alors la logicisation intégrale est la réalisation totale de la nature humaine, et c’est même l’avènement de Dieu sur terre : c’est la position de Hegel, qui fait le fond de toutes les idéologies new age de l’esprit global. Mais si avec Marx, Nietzsche, Husserl et toute la phénoménologie, on redéfinit l’homme par son corps vivant, sa chair, son rapport charnel à autrui, alors la logicisation intégrale devient une dénaturation, une aliénation et un danger, qui nous fait vivre dans un monde invivable et nous condamne à une existence abstraite, une vie inhumaine.
Il y a donc l’accomplissement d’une certaine forme de la rationalité, mais qui dans cet accomplissement se révèle dangereuse : d’où la nécessité de repenser la rationalité, ce qui là encore relève au premier chef de la philosophie. On découvre alors que ce que l’on prenait pour la raison depuis vingt-cinq siècles n’était qu’une forme « pervertie » de la raison : le mot est de Kant, et que ce soit Marx, Nietzsche, Husserl et la phénoménologie, tous vont s’attacher à dégager les fondements pré-rationnels de la rationalité, pour montrer que la rationalité scientifique s’est instituée en Grèce par l’oubli de son propre fondement, le corps, la vie, le chaos des affects, la praxis, le monde. Mais par là même, la crise n’a pas uniquement un caractère péjoratif, pour reprendre votre expression, elle est aussi révélation d’une vérité oubliée, et elle procure alors la possibilité de refonder la rationalité sur ses bases réelles. Il y a là la positivité de la crise, l’occasion historique de prendre un nouveau départ, en quelque sorte.
Mais à partir du moment où l’on reconnaît que la raison se fonde sur un niveau pré-rationnel, la question de l’unité de la crise doit être elle-même reprise sur ces bases : il s’agit de se demander quel est le processus réel, immanent au monde de la vie, immanent aux communautés humaines et à leurs pratiques, qui produit et institue cette rationalité abstraite, ce monde de pure essence. C’est la question de la généalogie ou de l’archéologie de la raison à laquelle s’est consacré Husserl. Il me semble que c’est Marx qui est allé le plus loin dans cette archéologie, en montrant dans la dialectique des échanges le processus de réduction des choses particulières concrètes à une quantité universelle et abstraite (la valeur d’échange), et dans la monnaie l’objectivation et la fétichisation de cet universel abstrait. Et de fait, l’avènement de la rationalité scientifique en Grèce ancienne est contemporain de l’avènement de la monnaie frappée et de Cités organisées autour du marché, l’agora.
Par suite, le fondement de la domination de la raison universelle et abstraite aujourd’hui, c’est la domination de la valeur d’échange, c’est le capitalisme : l’unité de la crise, c’est l’hégémonie du Capital. C’est alors ainsi qu’il faut repenser l’ambiguité de la crise. L’avènement du capitalisme est une catastrophe historique, menace d’une aliénation totale de l’être humain et la destruction totale de la terre, mais c’est aussi la révélation de la communauté humaine comme fondement de toute production de valeur, la révélation de « l’homme complet », « l’individu intégral » ou « individu universel » comme figure achevée de l’être humain, et la possibilité d’un renversement et d’une refondation, c’est-à-dire d’une révolution.
Dans Approche de la criticité, vous citez Céline : « La bourgeoisie, l’effort qu’elle fait, pour se croire encore en 1900… foutue mascarade ! » (Nord), en commentant « L’âge bourgeois de la modernité a succédé à l’âge aristo-clérical de la féodalité, mais le XXè siècle a progressivement dépossédé les propriétaires des moyens de production eux-mêmes. La réalité du pouvoir aujourd’hui est technocratique. ». Ce qui peut laisser penser qu’il n’y a guère plus de lutte des classes aujourd’hui.
Je ne dis pas du tout qu’il n’y a plus de lutte des classes. Il y a toujours des rapports sociaux conflictuels, et quand ils ne le sont pas, c’est simplement que les dominants sont très forts et que leurs moyens de domination sont très efficaces. Le financier multimilliardaire Warren Buffet l’a dit avec un cynisme rafraichissant : « Bien sûr qu’il y a lutte des classes, mais c’est ma classe, celle des riches, qui mène cette lutte, et nous gagnons ».
Je dis simplement ce que Marx le premier vous dirait : en 2018, les rapports sociaux ne sont pas ceux du XIXe siècle, et des analyses élaborées en 1860 ne valent plus aujourd’hui. Tout le monde le sait : contrairement à ce qu’il disait, les sociétés industrielles ne se sont pas définies par un antagonisme toujours plus grand entre bourgeoisie et prolétariat, mais par la croissance de la classe moyenne. Mais celle-ci peut être aussi expliquée sur les bases du capitalisme. Marx a analysé le capitalisme industriel du milieu du XIXe siècle, il ne pouvait pas anticiper ce qui s’est passé ensuite, à savoir l’avènement de la société de consommation, projet élaboré dans les années 1920 aux États-Unis en réaction à la révolution russe, qui consistait très clairement à conjurer la menace de subversion en augmentant les salaires des travailleurs. Avec un double avantage : d’une part faire des ouvriers, non plus des ennemis du capitalisme, mais des militants du consumérisme, et d’autre part fournir des débouchés à la production.
Donc ça, c’est le coup de génie du capitalisme au XXe siècle, qui fait qu’on a doublé le capitalisme de la production par un capitalisme de la consommation : la production de plus-value est fondée sur la surproduction, mais aussi sur la surconsommation. Le capitalisme ne s’est donc pas contenté de créer une classe de travailleurs, il a aussi créé une classe de consommateurs : la classe moyenne est la production méthodique, systématique, de la classe destinée à consommer tout ce qui est produit ; non pas de la chair à canon, mais des tubes digestifs. Avec les pathologies associées : Marx a montré les pathologies provoquées par le travail en usine, et on voit aujourd’hui les pathologies provoquées par la consommation (l’épidémie d’obésité, de diabète, etc).
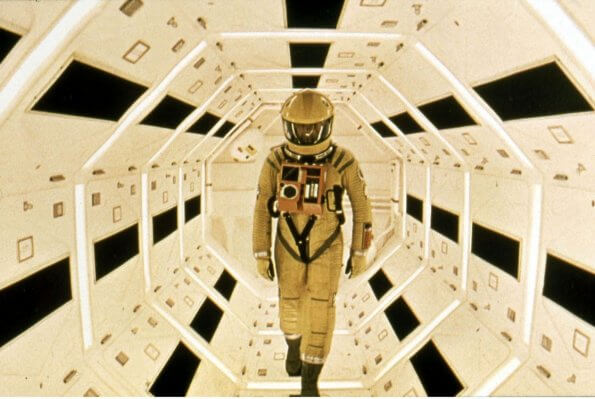
Mais si les rapports de classes ne sont plus les mêmes, c’est aussi parce que l’intrication du capitalisme avec la technologie modifie les rapports de pouvoir : à partir du moment où l’on a reconnu que la technique elle-même est une puissance dominante, il faut redéfinir la domination en terme de technocratie. On voit bien aujourd’hui que ceux qui dominent ne sont pas ceux qui sont seulement riches, mais ceux qui ont le savoir, les compétences techniques, les compétences intellectuelles qui permettent de maîtriser le fonctionnement du système. On n’est plus dans la France de Louis XIV, on a des systèmes machiniques qui sont d’une complexité inouïe, et il faut savoir comment ça marche. La question politique aujourd’hui est la question de la technocratie et des politiques contre la technocratie, c’est très difficile à élaborer. Il n’y a pas un propriétaire qui exploite quelqu’un d’autre, tout le monde est soumis aux mêmes processus, qui ont progressivement pénétré et infiltré les moindres interstices du champ social. Par exemple, le réseau Internet et le téléphone portable ont supprimé la différence entre vie professionnelle et vie privée, et ont ainsi accru la pression sur les travailleurs : on ne peut pas répondre à ça par un simple changement du régime de propriété.
C’est ce que vous dites dans la conclusion d’Approche : déniaiser la philosophie, c’est cesser de croire que la technologie est neutre et qu’on peut l’utiliser d’une bonne ou d’une mauvaise manière (genre « ce n’est pas la technologie qui est dangereuse mais ce qu’en font les gens »). La machine capitaliste et technologique pose problème en elle-même. Voyez-vous néanmoins des portes de sortie, des lignes de fuite, ou des moyens de casser la machine ?
Je ne suis pas sûr que ce soit au philosophe d’apporter des solutions. On répète souvent la 11ème thèse sur Feuerbach de Marx : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, ce qui importe c’est de le changer », mais toute l’œuvre de Marx montre que ce n’est pas aux philosophes de changer le monde, c’est au prolétariat. Justement, il va en permanence critiquer ceux qui ont réponse à tout et disent « J’ai un programme, on va l’appliquer ». Tout le Manifeste critique les utopies, les projets, les idéaux, etc. Pour Marx, le travail du philosophe, c’est de montrer dans la réalité où sont les processus en cours, il insiste ainsi sur le fait que le communisme n’est pas un idéal, c’est un processus à l’œuvre dans le monde industriel. Et en son temps il avait raison : il voyait à la fois le développement du capitalisme, et le développement du mouvement ouvrier, il était contemporain de la révolution de 48 et de la Commune de Paris. Il n’a jamais dit « J’ai une idée, j’ai un programme, faisons la révolution pour l’appliquer ». Il disait : il y a des processus en cours, il faut les éclairer, les accompagner, et puis aussi les légitimer contre l’enfumage idéologique de la bourgeoisie. Mais Marx ne prétend pas libérer les ouvriers, c’est à eux de se libérer par eux-mêmes, et de libérer du même coup l’humanité tout entière du joug du Capital.
Donc, il ne s’agit pas d’élaborer une solution théorique, puis ensuite de la mettre en œuvre. Si on veut être fidèles à Marx il s’agit de voir, dans la réalité contemporaine, s’il y a des processus sociaux qui ont engagé une sortie de crise. Il me semble que pour ce qui est des processus révolutionnaires aujourd’hui, tout le problème est qu’ils ne sont pas sociaux mais qu’ils sont technologiques. Ainsi la révolution Internet : non seulement là il y a une véritable révolution d’origine technologique, mais on voit bien que ce n’est pas la société qui s’exprime en elle, la société est atomisée par elle, elle la subit. Vous avez vu récemment les déclarations de l’ancien vice-président repenti de Facebook, qui a dit « nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social ». Il y a un processus révolutionnaire, mais celui-ci est antisocial. Aujourd’hui, l’avant-garde révolutionnaire, c’est Ray Kurzweil, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Jeff Bezos, c’est la Silicon Valley, qui conduisent la révolution technologique mondiale, dont les processus démantèlent, atomisent la société et donc l’empêchent de se constituer en force politique, et qui par ailleurs mettent en place des dispositifs tentaculaires (les GAFA) passablement totalitaire.
Justement, si on vous compare au Comité invisible, vous partez en gros des mêmes références (Nietzsche, Heidegger, Marx, Hegel, etc.). Mais ce qui vous sépare principalement, c’est que vous vous attelez à la description minutieuse du dispositif technique et objectif qui écrase la possibilité d’une révolution, alors que le Comité invisible s’intéresse plutôt à ce qu’on peut faire dans cette situation, aux possibilités d’action révolutionnaires (recréer de la communauté, défaire sa dépendance à la logique autonome du capital, fuir et attaquer). Comment situez-vous votre démarche par rapport à eux ?
L’insurrection qui vient est un texte que j’ai lu avec beaucoup d’admiration. Et ils ont effectivement raison de faire exactement l’inverse, ce travail là qui est absolument nécessaire : essayer d’identifier où sont les processus révolutionnaires aujourd’hui. Il y a incontestablement une démultiplication des alter, des volontés de subvertir et de s’éloigner du système, de faire sécession, ce qui peut être prometteur. Mais il me semble qu’il y a là surtout des mouvements de désertion vis-à-vis du dispositif, qui vont tenter de refaire communauté en dehors de lui, des communautés qui obéiront à d’autres principes. En se retirant ainsi, le problème est justement qu’on n’attaque pas le dispositif, qu’en réalité, ça ne le gêne pas du tout. Le problème est que cette stratégie est monacale : on va se retirer en dehors du monde, on vit dans des petites communautés où on va être bien ensemble, mais ça laisse le monde aller à sa perte. Faire défection, c’est une solution individuelle et à court terme, c’est un choix éthique et non une solution politique. L’urgence, ce serait de prendre à bras le corps ce gigantesque système, de le reprendre en main, justement. Et à partir du moment où il a échappé aux mains de tout le monde, le reprendre en main, c’est un problème colossal. On voit bien que même les conférences intergouvernementales sur le climat ne parviennent pas à manœuvrer le dispositif de production et à réfréner sa voracité.
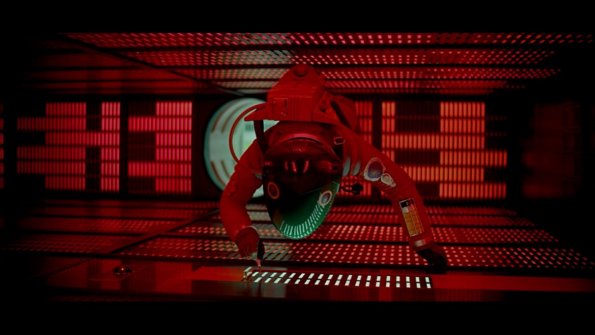
Mais il nous semble justement que la fonction du concept de « destitution », chez le Comité invisible, est de tenir ensemble une logique de désertion du monde institué, et une logique d’attaque de ces institutions. C’est un peu ce que fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple : à la fois créer un espace « monacal » de désertion où s’invente une nouvelle société, et en même temps, éviter l’isolement en sortant continuellement de la ZAD pour attaquer le capitalisme, que ça soit au sein des mouvements sociaux à Nantes et en Bretagne, ou au sein d’un réseau national et international d’anarchistes. Du coup, si vous tenez à éviter la trop grande marginalité qui peut caractériser ces luttes, votre position serait-elle plutôt celle d’un Andreas Malm, qui soutient la nécessité d’une prise en main de l’Etat pour mener à bien la transition vers un autre monde, pour détruire la machine ?
Le problème ici, c’est celui de la logique cybernétique (le terme a été proposé par Norbert Wiener en 1947 pour promouvoir une vision unifiée des différentes disciplines technologiques naissantes dans l’horizon d’une « théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l’animal que dans la machine »). Pour reprendre en main la machine — dont l’État n’est désormais qu’un des rouages —, il faudrait qu’elle soit manipulée par des êtres humains. La question c’est « Est-ce qu’il y a un pilote dans la machine ? ». S’il y en avait un, ce serait très clair, on saurait où est l’adversaire, il suffirait d’aller prendre les manettes à sa place. Le problème aujourd’hui est qu’il n’y a plus de pilote de la machine. La difficulté à l’admettre explique sans doute le complotisme : face à des processus planétaires anonymes, qui dépassent tout le monde, on va imaginer des assemblée occultes qui ont le système bien en mains et qui le manœuvrent à volonté. D’où les délires paranoïaques sur les Juifs ou les Illuminatis. Ce qui montre d’une part que l’absence de pilote dans la machine saute aux yeux, et que cette absence reste intellectuellement inconcevable.
C’est pour ça qu’il faut reprendre la question de la technique spécifiquement moderne, qui n’est rien d’autre qu’un processus systématique d’autonomisation des procédures, dans lequel on délègue de plus en plus de choses à la machine. Tout le problème de la technique aujourd’hui, c’est qu’on a déjà dépassé les seuils de ce qui est gérable par l’être humain. C’est vrai pour le Big Data, mais c’est vrai aussi et surtout pour la finance mondiale : à Wall Street, il n’y a personne, la Bourse n’est pas à Wall Street, elle est dans le New Jersey, où il y a d’immenses hangars qui abritent des centaines de serveurs informatiques. Un des grands moments, ça a été le krach boursier de 1987, qui a été causé par des erreurs humaines, à partir de là, on a dit « il faut supprimer les erreurs humaines, on va tout informatiser ». Tous les échanges se font désormais par ordinateurs parce qu’aucun être humain n’est capable de calculer assez vite, en prenant en compte autant de données, et de passer les ordres d’achat en quelques fractions de seconde, ce sont des processus intégralement machiniques et automatisés. L’architecture même du réseau est conçue pour qu’il n’y ait pas de tête, il a été conçu pour ça, dans les années 60, pour qu’en cas d’attaque atomique, le réseau ne puisse pas être mis hors d’usage par la destruction de son centre, il y a un système de relais qui lui permet toujours de se reconfigurer et de se redéployer.

Quant à la pure et simple destruction, il faut d’abord constater qu’on est dépendant de cette machine. Là aussi, la situation n’est plus celle du XIXe siècle. Quand Marx parle du capitalisme, il parle d’un système qui domine, mais pas toute la planète : à son époque, le capitalisme n’existe qu’en Angleterre, en Allemagne, en France, dans quelques pays d’Europe occidentale, mais ces pays sont encore largement ruraux ; aux États-Unis, ce n’est même pas sûr que l’on puisse vraiment parler de capitalisme, parce que l’économie repose encore en large partie sur l’esclavage et non sur le salariat. Donc à l’époque de Marx, le capitalisme ne concerne au plus que quelques pays, dont les sociétés ne sont pas entièrement soumises et reconfigurées par sa domination. Aujourd’hui ça concerne tous les pays du monde, 7 milliards de personnes interconnectées. Donc, on est dépendant, si la machine s’arrête demain, comment se nourrissent ces sept milliards de personnes ?
Voyez par exemple la délocalisation de la production agricole en Corée du Sud, qui n’a plus aucune terre agricole et qui est obligée d’acheter des terres en Afrique (ce qui par parenthèses montre jusqu’où va l’exploitation des peuples africains et le pillage de leurs ressources). La Corée du Sud a ses champs en Afrique, elle s’alimente par des navettes de cargos. On voit bien qu’on est dépendant pour manger, pour boire, pour se chauffer, de ce système de production et de circulation. La question, c’est celle du changement de mode de production, mais celui-ci ne peut pas s’improviser du jour au lendemain. La grande sagesse de Marx, c’est d’abord d’anticiper l’effondrement du système, mais aussi de préparer la relève, pour qu’il y ait un autre mode de production qui puisse prendre le relais, pour qu’il y ait une internationale des travailleurs organisée capable de prendre les choses en mains.
Aujourd’hui, si le capitalisme s’effondre, ça ne se fera pas en douceur parce qu’il n’y a pas de relève. L’effondrement viendra sans doute du problème de la dette, qui est désormais hors de contrôle. Mais la dette n’est pas du tout un problème des États, c’est un problème du Capital, c’est-à-dire de la monnaie de crédit et du système bancaire. Quand un banquier vous prête de l’argent, ce n’est pas de l’argent qu’il a dans ses coffres, il crée de la monnaie ex nihilo en ouvrant des lignes de crédit, parce qu’il compte sur votre travail futur pour créer de la valeur. Marx parle de « forme sans contenu » : la monnaie de crédit c’est une forme sans contenu, et c’est votre travail futur qui va remplir cette forme, qui va lui donner son contenu substantiel. Donc en toute rigueur des termes, un banquier est un faux-monnayeur, il inonde le marché de monnaie qui ne représente aucune valeur, en indexant cette valeur sur une activité de valorisation à venir.
Mais cette pseudo-monnaie joue un rôle majeur dans le capitalisme contemporain, ce que Marx nommait le capital fictif, un ensemble de titres, de traites, de dettes qui fonctionnent comme valeur dans les échanges alors qu’ils ne représentent qu’une hypothèse de valorisation. Aujourd’hui, 99% des échanges mondiaux concernent du capital fictif, pour 1% de marchandises réelles, et le capital fictif équivaut à 23 fois le PIB mondial : c’est-à-dire qu’il excède toute capacité de valorisation. Tout le monde le sait, c’est sans doute pour ça que les élites mondiales sont si cyniques et court-termistes, on vit dans une gigantesque bulle spéculative qui va finir par exploser. Donc ce que dit Marx sur l’effondrement du capitalisme, c’est effectivement une question de temps. L’urgence aujourd’hui, ce serait donc de préparer la relève. Au lieu d’envoyer les flics et les CRS contre les zadistes, les anarcho-autonomes, ceux de Tarnac, etc., il vaudrait peut-être mieux faire croître ces modèles alternatifs.
Votre livre s’ouvre sur la figure du consommateur ; l’exergue de Bob Dylan parle de puppets [marionnettes]. Vous décrivez plusieurs types de subjectivités produites par la cybernétique : 1) le solitaire, atomisé, « seul ensemble », 2) le neuneu, qui passe sa journée devant un écran, qui vit une deuxième vie à côté de la vie, une vie entièrement virtuelle (Facebook, SecondLife), 3) le schizophrène, la figure ultime, subjectivité traversée et informée par l’idéalisme calculant, qui se retire du réel, et qui est le produit d’un phénomène social de délire, de déni, une hallucination collective. Solitude, idiotie, schizophrénie, comment articulez-vous ces différents aspects ?
Il faut tout d’abord reconnaître le fondement pathologique de l’être humain. Edgar Morin disait qu’Homo sapiens est en vérité Homo demens, et je lui emprunte cette idée profonde et suggestive. C’est-à-dire qu’on ne peut pas définir l’humanité par la rationalité, par la sagesse, il faut définir l’humanité par une folie originelle. L’émergence de l’humanité au sein de la nature, ce n’est pas du tout l’émergence de la raison, de l’ordre et de la mesure. La nature est régulière, cyclique, ordonnée, prévisible, elle obéit à des lois rationnelles : l’avènement de l’homme est celui d’une démesure, une démence, un élément d’irrationalité. Nietzsche disait que l’homme est « l’animal malade », et qu’il n’y a pas de normalité, il montre que la quête de la raison pure est elle-même pathologiquement déterminée, elle est une volonté de fuir le chaos des affects pour se réfugier dans le monde des idées, où tout est en ordre et bien rangé. C’est-à-dire qu’au fondement même de la métaphysique, il y a une pathologie qui est la fuite du réel dans un monde fantasmatique, c’est-à-dire une schizophrénie.
C’est ainsi que Freud analyse la métaphysique : Freud en effet ne fait pas uniquement la critique de la religion en disant qu’elle relève de la névrose, il fait aussi une critique tout aussi radicale de la métaphysique, en disant qu’elle relève de la psychose et de la schizophrénie, c’est-à-dire d’une fuite en dehors du monde, d’un refuge dans un délire hallucinatoire caractérisé par la surestimation des phénomènes endopsychiques et la tendance à prendre les idées pour des choses. Or c’est précisément cette attitude que systématise le dispositif médiatique : dès les années 1960, Joseph Gabel et Guy Debord ont vu dans la schizophrénie la subjectivité spécifique au capitalisme. Le système médiatique contemporain va produire de la schizophrénie, justement parce qu’il impose à chacun une dissociation, un clivage (une Spaltung) entre la vie concrète-réelle et cette vie hallucinatoire.
On vit tous en schizophrène : on a tous une vie concrète, et la tête dans un ensemble de données qui ne viennent pas de notre monde environnant réel, celui qui est éprouvé par notre corps, mais qui viennent du dispositif technologique spectaculaire. Les pieds sur terre et la tête dans le cyberespace, telle est notre condition. Les rues sont aujourd’hui pleine de gens qui parlent tous seuls en agitant les bras dans tous les sens, c’est juste qu’ils ont une oreillette bluetooth et qu’ils sont au téléphone, mais il y a vingt ans, il n’y a que les psychotiques qui faisaient ça. S’il faut retenir un concept central de subjectivation contemporaine, c’est celui de schizophrénie, et il contribue à mettre en relief le rapport entre le dispositif technologique et la métaphysique.
Le schizophrène est celui qui est déconnecté de sa vie concrète, donc du rapport concret aux autres, et qui est directement connecté à l’idéalité, et c’est pourquoi il est seul, au sens de la solitude monadique et atomistique. Par sa connexion immédiate au dispositif, il peut être déterminé par le code, le spectacle, le prix, sans plus jamais passer par la médiation d’autrui. C’est un processus d’atomisation sociale qui est une modalité de socialisation propre au Capital, c’est pourquoi il y a totalitarisme : chaque individu va pouvoir être commandé totalement par l’idéalité sans médiation. La solitude atomistique est directement liée à la cybernétique, le capitalisme est totalitaire justement pour cela. Hayek ne démontre rien d’autre : justement, que chaque individu va pouvoir être déterminé par le prix donc par le code, sans médiation sociale de quoi que ce soit.

Si la cybernétique produit effectivement de telles subjectivités aujourd’hui, est-ce que l’amour et l’amitié, qui font la qualité des liens entre les personnes et l’intensité d’une vie, ne seraient pas au coeur d’une politique anti-cybernétique ?
Reprendre chair, retrouver l’amour et l’amitié comme formes politiques de resubjectivation, c’est bien sûr des possibilités de libération. Ce sont les modalités de subjectivation antischizophrénique aujourd’hui. On a là le débranchement par rapport au dispositif et le tissage de nouveaux liens réels pour faire communauté. C’est indispensable, c’est une stratégie de survie pour chacun d’entre nous, pour respirer, pour reprendre chair, pour créer des oasis ou des jardins où le Moloch du Capital ne nous atteindra pas. Il ne faut surtout pas sous estimer cette éthique de l’amour et de l’amitié comme principe de désertion, il est même possible que ce soit la seule voie raisonnable : ce serait la seule voie dans le cas où ce serait déjà trop tard, où il ne serait déjà plus possible de renverser la vapeur, en quelque sorte. C’est une des branches de l’alternative. L’autre est politique, c’est la reprise en main du dispositif planétaire, et donc le passage de la communauté éthique à la communauté politique. Par exemple, si moi je n’ai pas de compte Facebook, ça n’empêche pas Mark Zuckerberg de dormir. En dix ans on est passé à deux milliards d’utilisateurs sur Facebook. Pour refaire communauté réelle, il faudrait une désertion en masse, pas des désertions individuelles. Si on veut abandonner l’éthique pour la politique, alors la question fondamentale devient : comment on fait pour convaincre deux milliards de personnes?
Est-ce qu’il n’y a pas une ambivalence des outils technologiques contemporains ? L’exemple de l’usage de Facebook/Twitter lors des révolutions arabes est souvent avancé. Est-ce qu’on ne pourrait pas ainsi trouer le dispositif, en retournant ses armes contre lui ?
Il y a possiblement dans les techniques contemporaines les modalités de leur propre subversion, mais il faut au préalable que l’impératif révolutionnaire ce soit imposé, et de l’extérieur. L’exemple des révolutions arabes est un bon exemple : la révolution n’est pas venue de l’intérieur de Facebook, il faut qu’à l’origine ces individus se soient déjà constitués comme des sujets révolutionnaires. En Tunisie, c’est parce que des gens avaient faim, qu’ils étaient au chômage, qu’ils n’avaient aucune perspective, qu’ils étaient désespérés, qu’ils se mirent à se vivre en tant que corps qu’ils sont entré dans une dynamique révolutionnaire. C’est la communauté révolutionnaire ainsi formée qui s’est ensuite servie de Facebook. En somme, pour que les deux milliards d’utilisateurs de Facebook se mettent à user du dispositif autrement, il faudrait qu’il y ait un événement réel, dans le monde réel, qui leur permettent de s’arracher à leur aliénation. Par ailleurs, je ne vous apprends rien en vous disant que les services de polices surveillent constamment les réseaux, y compris en temps réel pendant les manifestations en France, pour étouffer dans l’œuf tout mouvement insurrectionnel. Les outils technologiques sont aussi de puissants moyens policiers.
Est-ce que votre position n’amène pas alors à un certain attentisme politique : il faut attendre que la situation soit « propice » ?
Pour moi, ce n’est pas de l’attentisme, c’est la retenue du philosophe qui n’entend pas dire aux autres ce qu’ils ont à faire, et qui ne croit surtout pas détenir la solution à mettre en œuvre. Je ne dis pas aux autres d’attendre, je me borne à essayer de voir ce qui se passe. Il y a certes des poches de résistance, une multiplicité de formes de résistance, mais elles ne constituent pas une nouvelle Internationale. Ce que pense Marx, c’est que face à la puissance du Capital, il faut une force constituée qui s’appelle l’Internationale. Je constate que pour l’heure, ce n’est pas le cas, il n’y a rien d’évident en tout cas, il n’est absolument pas évident que quelque chose se passe. Au temps de Marx, quand on regarde la Commune, il est manifeste qu’il y a des processus sociaux, que les ouvriers ne vont pas se contenter de défiler gentiment de la place de la République à celle de la Nation, mais qu’ils vont vraiment essayer de prendre le pouvoir.
Vous vous sentez proche d’autres auteurs contemporains ?
Proche, je ne dirais pas ça. J’aime beaucoup la phrase de Heidegger : « Nous marchons tous sur notre propre chemin, mais dans la même forêt ». Il y a effectivement une communauté de pensée et de critique, je peux me nourrir de Slavoj Zizek, Giorgio Agamben, Peter Sloterdijk, Anselm Jappe, en France j’admire beaucoup le travail de Pierre Dardot et Christian Laval, celui de Franck Fischbach, je suis un lecteur fidèle de Jean-Claude Michéa. Mon propos n’est pas très original de ce point de vue là. Mais en fait, je lis surtout des livres d’histoire. N’importe quel livre d’histoire est intéressant, ce qui est loin d’être le cas des livres de philosophie.
Plus généralement : quel est votre but, quand vous écrivez un livre ? Qu’est-ce que vous pensez qu’un livre peut faire ? Si la tâche de la philosophie c’est de rendre visible des processus, de ne pas être dupe, quelle puissance peut avoir un livre ?
La réponse est claire et nette : aucune. Comme disait Sartre, « face à un enfant qui meurt de faim, La Nausée ne fait pas le poids », un livre est dérisoire face à la misère du monde et à l’urgence de la situation. Et un livre n’a jamais d’effet par lui-même : le Manifeste du parti communiste a été publié en 1848 dans l’indifférence générale, ce qui a été important, c’est la fondation de la première Internationale, et ce sont ensuite les syndicats et partis qui ont donné son importance à ce livre. Ce qui là aussi devrait conduire à calmer le jeu sur le cas Heidegger : même s’il y a une dérive nazifiante dans sa réflexion des années trente, celle-ci n’a pas provoqué de mouvements fascistes de masse qui pourraient constituer un quelconque danger politique, elle n’a fait qu’occasionner des polémiques picrocholines dans les milieux universitaires. Il faut rester modeste sur la portée de l’artisanat philosophique. Donc l’enjeu pour moi c’est simplement de garder les yeux ouverts, d’être lucide, de me prémunir contre l’enfumage idéologique du dispositif spectaculaire.
Ensuite, ce qui est extraordinaire quand on écrit des livres, c’est qu’il y a des gens qui les lisent. Il est alors possible de recréer des sortes de communautés invisibles entre ceux qui partagent les mêmes inquiétudes et les mêmes interrogations : on se sent moins seul, ce qui n’a pas de prix. Mais la question, vous avez raison, c’est en effet de savoir ce que peut la philosophie, si elle est aujourd’hui autre chose qu’un sous-genre littéraire à destination des classes moyennes-supérieures des pays occidentaux. Il faut toujours se demander ce que voulait faire un philosophe, et ni Marx, ni Nietzsche, ni Husserl ni Heidegger n’avait pour ambition de fournir une matière première pour l’usine à thèses et à colloques qu’est devenue l’université. Ils n’étaient pas modestes du tout, eux, ils voulaient opérer une cassure dans l’histoire mondiale, un dépassement réel et effectif du nihilisme, un nouveau commencement. Et force est de constater qu’ils ont tous échoué. Et si ces géants ont échoué, ce n’est pas moi qui vais y arriver, et ce d’autant plus que la situation est largement plus critique aujourd’hui qu’elle ne l’était en leur temps.
Mais il reste possible de réfléchir sur cet échec, et ce à partir de ce point de vue qui considère notre époque comme la seconde révolution dans l’histoire de l’humanité. On peut alors la mettre en perspective en réfléchissant sur la révolution néolithique. Il faut revenir sur ce texte crucial qu’est la Genèse dans l’Ancien Testament. On sait qu’il a été écrit à partir du VIIIe siècle avant le Christ, mais qu’il reprend des traditions babyloniennes beaucoup plus anciennes, il cristallise ainsi une réflexion sur l’émergence de la civilisation au Proche-Orient. La sortie du Jardin d’Eden, c’est le passage du nomadisme à la sédentarité, le passage d’un état où tout était donné à un état où il va falloir tout produire, « à la sueur de son front », Caïn et Abel, ce sont les premiers agriculteur et éleveur.
Ce qui est remarquable, c’est que ce passage est conçu comme une chute, une malédiction, comme le début des ennuis, et l’archéologie le confirme : le bon temps, c’était le paléolithique (voir l’ouvrage classique de Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance). Ni la sédentarisation ni l’agriculture n’avaient rien de nécessaire, on comprend mal d’ailleurs pourquoi les hommes se sont imposés le travail harassant de la terre alors qu’ils pouvaient largement vivre de la cueillette des légumineuses et des céréales sauvages, que le gibier était abondant, et que ce nouveau régime de production a d’emblée provoqué des conflits et des problèmes sociaux. Donc un proto-Marx mésopotamien aurait pu dire : attention, la révolution néolithique, c’est dangereux. Mais comment agir sur un tel processus ? Était-il possible de l’interrompre, de le dominer et de le manœuvrer ? Ce mode de production a créé une explosion démographique et a donné un pouvoir aux Cités-États de Mésopotamie qui leur a permis de dominer et d’absorber les peuples nomades alentour, et donc d’imposer la néolithisation : la puissance était du côté des peuples sédentarisés.
La révolution industrielle est un événement de même envergure, et de même elle a donné aux pays industrialisés une puissance qui leur a permis de dominer la planète et d’imposer leur mode de production, leur technologie, leur interprétation scientifique du monde, leur dispositif spectaculaire. Face à cet événement, il y a peut-être une démesure, une hubris, à croire qu’on va pouvoir l’infléchir, c’est la dimension prométhéenne du projet de Marx : conjurer un destin tragique pour sauver l’humanité. Alors peut-être qu’il n’y a rien à faire, peut être qu’Homo sapiens va devoir passer le relais à un Homo numericus, ou peut-être que la catastrophe globale va emporter l’être humain. L’état du savoir aujourd’hui nous impose de l’envisager : d’abord l’espèce humaine est apparue et a survécu un peu par hasard, ensuite, des extinctions d’espèce, ça arrive, c’est même assez fréquent de nos jours. L’espèce humaine disparaîtra, ce n’est qu’une question de temps. D’ici là, essayons de vivre debout pour ne pas mourir à genoux.
Vous avez du pain sur la planche ?
J’ai fini un petit livre sur Marx et la philosophie qui devrait paraître en septembre. Mais je n’aime pas parler de mes travaux en cours. Je lis des choses diverses et variées, j’observe et je réfléchis, et puis ça cristallise, ou pas.




